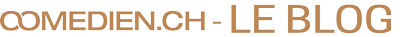La jungle du mythique Festival d’Avignon
Série en 3 volets
Effervescence, enthousiasme, intensité. Avignon, chaque été, se transforme en véritable fourmilière artistique.
Je garde en mémoire un piano à queue sous une arche de pierre, apparu au détour d’une ruelle, des théâtres éphémères installés dans des cours ou des caves réaménagées, la chaleur estivale le long du canal, les affiches collées jusque dans les hauteurs pour émerger du foisonnement visuel du centre-ville, et les artistes défilant dans les rues pour séduire le public.
Mais derrière la vitrine, un autre visage : nombre de compagnies rentrent ruinées, quand quelques-unes seulement décrochent le succès et de futures tournées.
Festival adulé ou critiqué, Avignon ne laisse personne indifférent.
Cette série en trois volets explore les coulisses de ce rendez-vous incontournable à travers les expériences contrastées de deux compagnies suisses présentes en 2025 et le regard de la directrice de la Sélection Suisse en Avignon.
Quelles créations ont porté les comédiennes Marjolaine Minot et Joëlle Fontannaz ? Quel est leur univers ? Comment chacune s’est-elle battue pour faire émerger son spectacle au milieu de la profusion du festival ? Deux parcours très différents dont les mêmes questions se feront miroir d’un article à l’autre.
1. Marjolaine Minot, l’art en autoproduction
L’une d’elle, la Cie Marjolaine Minot, y est allée en autoproduction, pour la troisième fois.
- Joëlle Fontannaz, le sésame de la Sélection Suisse
La Fair Cie, dirigée par Joëlle Fontannaz, a bénéficié du précieux sésame de la Sélection Suisse en Avignon, qui soutient chaque année quelques compagnies triées sur le volet.
- Esther Welger-Barboza, tisser la présence suisse à Avignon
Le dernier entretien donnera la parole à Esther Welger-Barboza, directrice de cette fameuse Sélection Suisse en Avignon, qui nous éclairera avec passion sur les ficelles de son métier.
Joëlle Fontannaz, le sésame de la Sélection Suisse.

Joelle Fontannaz_Portrait_©Anne-Laure Lechat
Comment s’est déroulé Avignon 2025 pour toi?
Très bien. Au début, nous devions reprendre nos marques. A Avignon, les spectacles défilent les uns après les autres sur la même scène. Il fallait donc s’habituer au temps restreint des transitions, trente minutes seulement, afin mettre en place notre décor sur le plateau, régler les lumières et vérifier si tout fonctionnait comme voulu. Le rodage de ces déplacements, travaillé en amont, a dû être affiné les premiers jours afin de gagner en fluidité. Ensuite, la difficulté était que la pièce a été construite avec une écriture hybride mi-fixée, mi-improvisée. A sa création, en 2022, elle était totalement orale. Une structure avait été établie pour la reprise à Gogogo au Grütli l’année suivante. Pour Avignon, nous nous sommes également basé·es sur la captation vidéo. Le défi était alors de retrouver l’organicité de l’écriture orale tout en s’appuyant sur ces supports fixes. J’avais une certaine appréhension quant à la réaction du public français face à cette pièce. En conséquence, les cinq premiers jours, avec les réglages techniques réalisées dans un temps limité, j’étais un peu hors de mon corps. Deux ans et demi s’étaient écoulés depuis la dernière représentation également. Cela n’a pas empêché la première représentation de décoller. Nous avons été complètement porté·es par la réception ultra réactive du public. Lors de la deuxième par contre, je devais comprendre à nouveau comment entrer dans cette narration. Et me rappeler que l’important était de revenir à l’histoire que nous racontions et d’avoir confiance en la forme singulière du spectacle, que cette dernière suivrait par ellemême. Une fois nos marques prises, nous nous sentions à l’aise, chez nous.
Combien de représentations avez-vous donné?
Onze.
Comment le spectacle a-t-il été reçu?
Nous avons toujours eu du monde. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Le sentiment de partage avec le public était présent. Ensuite, à Avignon, l’enjeu de la presse est fort. Je le savais car je suis déjà venue précédemment en tant qu’interprète. La Sélection Suisse effectue un grand travail auprès de la presse. Nous n’avons pas pour autant une garantie que des articles flatteurs concernant notre pièce seront écrits. Si le·la journaliste n’aime pas, généralement, il·elle ne publiera rien ou alors des articles très critiques. Ceci produit logiquement une certaine appréhension chez les artistes.
Avez-vous bénéficié d’articles de presse?
Beaucoup d’articles ont été consacrés à ma pièce. La presse française, bien plus étendue que la presse suisse, offre une belle visibilité sur le territoire français. Ce qui m’a particulièrement touchée c’est qu’en plus d’avoir eu une presse très positive, je remarquais que ces journalistes avait saisi mon travail. Le fameux adage « nul n’est prophète en son pays » m’a parfois traversé l’esprit.
As-tu l’impression que ton spectacle a récolté davantage de succès à Avignon qu’en Suisse?
A la création, au Théâtre 2.21, la presse ne s’est pas manifestée et seulement quelques programmateur·trices ont assisté à une représentation. A Genève, au Grütli où nous avions eu deux dates, davantage de professionnel·les de la culture se sont déplacé·es et ont permis de donner un élan à la pièce. Par contre, déjà à sa création et lors de sa reprise, la réception du public avait été très bonne.
Le partage avec l’audience a aussi résonné fort à Avignon. J’ai souvent entendu des réflexions comme « Ah, ça fait du bien de rire ! ». Sans parler de rire en termes de se bidonner. J’ai l’impression que ce spectacle correspond à un moment où la France est morose. Par conséquent, les personnes avaient l’air très friandes de cet univers absurde et décalé qui, l’air de rien, aborde des thèmes forts comme par exemple le dérisoire de notre humanité. Et avec tous·tes les programmateur·rices qui sont venu·es, nous avons bénéficié d’une superbe visibilité que je n’ai pas ressentie jusque-là en Suisse.

L’événement ©25Deblue
De quoi parle ta pièce?
« L’événement » a été créé au Théâtre de 2.21 et son point de départ s’inspire d’une base documentaire composée de plusieurs interviews où chacun possède un point de vue différent sur un même événement qui s’est réellement déroulé sur une île grecque.
Il relate l’histoire d’un four à pain qui a brûlé dans une communauté, ce qui a failli provoquer un incendie sur toute l’île. Quelqu’un, miraculeusement, s’est réveillé au milieu de la nuit, ce qui a permis d’éteindre le feu.
Ma volonté première était de parler de la question du collectif et à plus large échelle, comment être à plusieurs en prenant en référence le fameux « vivre ensemble ». Ce mode de vie me semble complexe, cependant possible au prix d’un certain travail. Et ce « travail » m’intéresse beaucoup. En effet, je ne désirais pas montrer la défaillance du collectif mais plutôt donner à regarder ce qu’il nécessite.
Nous parlons donc d’un non-événement et non d’une tragédie. Si toute l’île avait été brûlée, nous aurions alors évoqué un drame.
Quelle sont les particularités du spectacle?
La spécificité de ce spectacle a été mon désir que la forme reflète la thématique et donc qu’elle raconte, elle aussi, les enjeux de la vie en collectif. J’aime créer des dispositifs qui contraignent les acteur·trices à être vraiment ensemble au plateau.
Ici, la règle implique que nous racontions en même temps une histoire identique, mais chacun·e avec ses propres nuances et son avis. Pouvoir relater un même récit dans trois modes différents a nécessité un grand travail d’écriture. Et ceci est devenu le terrain de jeu des trois comédien·nes, Mathias Glayre, Nina Langensand et moi-même.

L’événement ©25Deblue
Peux-tu donner des exemples?
Nous avions des points de rencontre, comme un silence fixé après l’évocation de tel élément ou un instant où nous sommes obligé·es d’être ensemble. Ces rendez-vous créaient un squelette absolument vital au récit et donnaient par la suite la liberté de se lâcher, d’aller davantage dans l’improvisation pour les phrases suivantes. Au tout début de la pièce, la trame est très précise puis prend, petit à petit, de la porosité.
Cette part d’improvisation exige un grand lâcher-prise que nous devons réellement accepter. Accepter que peut-être l’un·e d’entre nous raccourcisse tout à coup un silence. Ceci met en exergue la question de l’auteur·e de la partition, du·de la chef·fe et par conséquent, de la communauté. La forme même de la narration devient une expérience collective.
Pouvoir différencier l’indication d’un chemin où tes partenaires de jeu te suivent, tout en amenant leur propre particularité, plutôt que d’imposer une direction où les autres courent derrière.
Ce spectacle nous oblige à réellement éprouver ce que signifie lâcher prise dans un groupe et en quoi consiste le fait de prendre ses responsabilités, puisque si l’un·e de nous s’enferme dans trop de politesse, il ou elle reste coincé·e à écouter sans prendre d’initiative. La trame de l’histoire, alors, n’avance plus. Il est nécessaire qu’à tour de rôle nous prenions la responsabilité de mener la narration à une autre étape.
Si nous parlions les trois ensemble, avec des mots différents, ce qui était accepté et même désiré par moment, nous devions être capable d’entendre ce que chacun·e évoquait. Sinon, cela signifiait que nous n’écoutions plus et que nous nous cantonnions chacun·e à notre propre idée. Ces questions d’écoute et de responsabilité sont au coeur du théâtre et de la collectivité.
Nous nous devons d’être à l’écoute puisqu’un canevas est écrit mais qu’il y a aussi une marge d’improvisation et de réinvention. Nous ne sommes pas au mot près, mais malgré tout certaines phrases identiques reviennent à chaque représentation. Les enjeux restent fixes. Et parfois, si nous sommes réellement présent·es, à l’écoute de la forme que la pièce prend ce jour-là, nous devons être capable de ne pas systématiquement prononcer ce que nous avions prévu si, finalement, ce n’est plus nécessaire de le transmettre. Peut-être qu’un·e des autres comédien·nes l’a déjà pris en charge ou éventuellement, la narration est déjà passée plus loin. Nous sommes, en effet, obligé·es d’abandonner une pensée à laquelle nous étions possiblement attaché·es pour rester au service du récit commun. Nous sommes constamment dans une réévaluation et une hyper vigilance. Cette dernière procure une présence très particulière aux personnages, ce qui, je pense, est également une des singularités du spectacle. Cette présence contient une tension qui a parfois besoin d’éclater. Lorsque finalement celle-ci lâche, en ressort une certaine libération, tant pour les comédien·nes que pour le public. Nous vivons la construction de ce récit ensemble, audience et artistes.
… Je parle beaucoup lorsque je suis amenée à m’exprimer sur cette recherche. (Rires).
Maintenant que les lecteurs ont pu prendre connaissance de ton travail, repartons à Avignon. Comment s’y déroulait ton quotidien?
Nous nous retrouvions à 15h30 pour une séance de yoga nidra, conduite par Mathias Glayre, afin de trouver une détente profonde. Puis, nous arrivions à 17h au théâtre pour le maquillage. Simultanément, nous échangions, si besoin, sur les notes transmises en début de journée concernant la représentation précédente. A 18h, nous installions en trente minutes la scénographie, puis nous nous partagions une intention pour la nouvelle représentation, juste avant que le public n’entre.
Lors de la première semaine, je visionnais, chaque jour, la captation du spectacle joué la veille et nous prenions davantage de temps pour échanger vu que nous ne l’avions plus joué depuis deux ans.
A Avignon, j’ai souvenir de ces ruelles ensoleillées parsemées d’artistes en train de distribuer des flyers afin d’attirer du public dans leur salle. Est-ce que vous tractiez beaucoup dans les rues?
Une personne est employée par la Sélection Suisse pour effectuer cette tâche. La distribution des flyers a lieu surtout autour du programme IN.
Le focus est avant tout orienté vers les programmateur·rices. Pour cette raison, Esther Welger-Barboza, la directrice, organise un lunch, une sorte de quart d’heure américain où artistes et professionnel·les de la culture se rencontrent. Un choix a été effectué en amont afin de cibler au mieux les affinités. Souvent, ils ou elles ont déjà vu le spectacle, ce qui permet de discuter du travail, d’approfondir les échanges et si possible, de développer une collaboration par la suite.

L’événement ©Vicky Althaus

L’Evenement – Pascal Gely _ SCH 2
Qu’apprécies-tu dans ce festival?
Une impression de suspension. Les spectateur·ices sont entièrement disponibles à recevoir et sont très généreux·ses. Ils et elles se trouvent à Avignon uniquement pour assister à du théâtre. C’est beau! Et puis le climat, assurément. La lumière du sud. Je comprends pourquoi tellement d’artistes viennent peindre cette luminosité.
Il y a dans l’atmosphère une sensation d’instant privilégié, une forme d’effervescence, d’intensité commune.
Avec cet état du monde, notamment le génocide à Gaza, mais aussi et sans aucun mesure comparable au massacre en Palestine, les réalités des coupes financières au niveau culturel en France, un goût étrange d’utopie reste en bouche.
En Suisse, teinté·es de notre histoire protestante, je trouve qu’il nous est plus compliqué d’appliquer l’art de la fête ou simplement l’acte d’honorer. Les français ont ce savoir-faire et en l’occurrence, les rencontres sont spontanées et simples. Une fête du théâtre. Nous nous retrouvons aussi confronté·es aux gratins (de pâtes) que sont les verrées avec les professionnel·les de la culture. Autour du vin blanc et la viande séchée, nous plongeons alors dans cette valse inévitable de regards qui se font ou ne se font pas. Un jeu qui peut être assez déstabilisant et confrontant selon la disposition dans laquelle nous nous trouvons. Mais qui est aussi une part du système, voire du métier, et à ce titre c’est un aspect formateur concernant son propre positionnement dans ce jeu, si l’on ne s’y perd pas.
L’esprit de la Sélection Suisse en Avignon est généreux lui aussi. Tu es embarqué·e dans une aventure. Sortir du petit territoire qu’est la Suisse romande où tout le monde te connaît a ses avantages et ses inconvénients.
Ici, les programmateur·trices et le public ne savent pas qui tu es. Leur regard est donc sans filtre. Par conséquent, tu ne te retrouves jamais dans la complaisance, ce qui est très formateur. Tu ne peux que continuer à travailler, à chercher et observer ce que ton spectacle produit. Ceci est fondamental.
Qu’est-ce que tu n’aimes pas?
Ce festival est si vaste! Je l’ai vécu de mon prisme.
Nous ne traversions jamais le centre pour éviter la foule et nous logions en-dehors des remparts. Je me suis sentie privilégiée, mais encore une fois, parce que l’équipe de la Sélection Suisse nous entourait. Les aspects stressants étaient pris en main, comme le souci des lumières qui fut très vite résolu par le directeur technique de la Sélection. Bien sûr, dans un monde idéal, tu as la possibilité de procéder à deux ou trois filages. A Avignon, ceci est impossible et tu dois te prêter au jeu et ses circonstances.
Avec la presse, les programmateur·rices, ce festival frôle l’impression de n’être qu’une vitrine. Ce qui risque de l’affubler d’une perspective essentiellement mondaine. En même temps, grâce à cet évènement, notre travail est présenté. Il s’agit d’une grande et belle opportunité. Dans ce contexte, la présence d’un public généreux devient d’autant plus importante. Je n’ai pas senti « la vitrine » car dans la salle se trouvaient Monsieur et Madame tout le monde. Cependant, ces dernier·ères représentaient une certaine classe sociale. La diversité devrait être sécouée, impulsée dans ce festival. La grande majorité du public provient d’une classe moyenne, blanche, mais heureusement de tous âges confondus.
Et la Sélection a cela de bon que d’un côté, elle nous confronte à cette vitrine, et en même temps, elle nous en protège. Ne se préoccuper que de la visibilité de notre travail peut nous éloigner de notre but premier: jouer le spectacle. Nous devons en effet, chaque jour, le restituer avec les exigences qu’il implique. Jouer, mettre en place le décor, ne pas être dans la salle uniquement en tant que metteuse en scène, m’a protégée de ce « cirque » sur lequel nous n’avons aucune prise, à savoir observer la venue ou non des professionnel·es ainsi que leur réaction. Grâce à la Sélection Suisse j’ai pu avoir une diffuseuse, Clémence Faravel qui s’occupait de faire le lien avec les programmateur·rices tandis que je pouvais rester concentrée sur le travail du jeu et de la mise en scène. Leur soutien m’a également permis de ne pas dépendre du nombre de spectateur·ices pour les financements, ce qui enlève une pression supplémentaire pour la Compagnie.
As-tu déjà amené auparavant d’autres spectacles?
En tant que porteuse de projets, c’était la première fois. Par contre, je suis déjà venue plusieurs fois en tant qu’interprète via la Sélection Suisse: l’année dernière avec le spectacle d’Adina Secretan et en 2018 avec Joël Maillard. Ou sans ce soutien, notamment, avec Philippe Saire.
As-tu ou non senti une différence lorsque vous bénéficiez du soutien de la Sélection Suisse?
Dans le cadre de la Sélection nous jouions à chaque fois dans des lieux excellents en terme de situation ou d’atmosphère (intra muros, la Chartreuse à Villeneuve Lèz Avignon) et à des horaires agréables. Pour « Angels in America », pièce hors sélection, les représentations étaient à 22h dans une patinoire en banlieue. Le public provenait d’une navette qu’il reprenait aussitôt le spectacle terminé. Je rentrais à vélo à 1h30 du matin en traversant des zones industrielles désertes. Autant dire que cela n’a rien à voir en terme de qualité de vie au quotidien. Mais peut-être était-ce un hasard.
Sinon, la spécificité de la Sélection est l’encadrement de l’équipe. Il est rare, dans notre métier, d’être à ce point relié·es aux personnes de la direction, de la production, de la diffusion et de la presse. Esther, la directrice, et Nataly, l’administratrice, étaient telles des coachs et de vraies interlocutrices. Christophe Poulx a été d’un soutien incroyable lors de la mise en place du spectacle à ses débuts, il a trouvé des solutions pour que cela roule « comme sur des roulettes » au sens propre comme au figuré! A la fin de chaque représentation, ils·elles étaient généralement présentes. Habituellement, dans les théâtres, les responsables assistent à la Première, mais rarement plus. La Sélection organisait également des petites fêtes qui marquaient les arrivées et départs des artistes sélectionné·es et qui nous permettaient, l’air de rien, de nous rencontrer et d’échanger sur nos expériences respectives. Ces instants où nous pouvons élargir des liens et des connaissances avec des d’autres personnes du milieu sont très précieux et riches.
Quand tu es chef·fe de projet, tu dois tout tenir et tu te confrontes à tes doutes seul·e. Cette position est souvent solitaire. Avec l’équipe de la Sélection, un sentiment de fort soutien et d’appartenance à un groupe en émanait. Ces dimensions sont notables et à préserver dans notre milieu.
Quand tu es chef·fe de projet, tu dois tout tenir et tu te confrontes à tes doutes seul·e. Cette position est souvent solitaire. Avec l’équipe de la Sélection, un sentiment de fort soutien et d’appartenance à un groupe en émanait. Ces dimensions sont notables et à préserver dans notre milieu.
De qui parles-tu quand tu évoques l’équipe qui vous entourait à la Sélection Suisse?
Pour 2025, de la directrice Esther Welger-Barboza, de Nataly Sugnaux Hernandez pour l’administration et la diffusion et de Christophe Poulx pour la direction technique.
En arrière-plan, l’agence MIRA s’occupait de la presse.
Comment s’effectue l’organisation pour venir à Avignon dans le cadre de la Sélection suisse?
Le théâtre est attribué par la Sélection Suisse. Celle-ci prend en charge tout ce qui concerne Avignon d’un point de vue production et financements. En revanche, la compagnie s’occupe des demandes de fonds pour les répétitions du spectacle et réserve les hébergements et les transports. Elle doit également trouver une personne responsable de la diffusion. Esther, la directrice de la Sélection, reste à disposition pour conseiller.
J’ai beaucoup délégué à Michael, Scheuplein, mon administrateur, qui s’est occupé de la question des contrats et d’autres points à gérer. Je me suis vraiment concentrée sur la reprise de la pièce.
La compagnie organise également le montage technique et le filage qui s’effectuent sur place pendant trois jours, en amont du festival. Le directeur technique de la Sélection est également présent.

L’événement ©Vicky Althaus
Comment as-tu été choisie pour la Sélection Suisse?
L’année passée, j’ai rencontré Esther à Avignon car je jouais dans le spectacle « Une bonne histoire », mis en scène par Adina Secretan, alors sélectionné. Nous avons sympathisé et elle a apprécié mon travail en tant que comédienne. En 2023, elle avait vu « L’évènement » au Grütli.
Je pense que les thématiques lui parlaient, celles du vivre ensemble, mais aussi du danger de l’embrasement qui plane.
Donc, à la première de mon dernier spectacle « De la table ronde » joué au 2.21 en début 2025, Esther est venue vers moi et m’a proposé de venir à la Sélection.
Et j’ai accepté.
En 2022, durant les deux semaines de représentations au Théâtre 2.21, nous avions observé, pour « L’événement », l’affluence augmenter à mesure que les jours passaient et ce, grâce au bouche à oreille. A la fin, nous affichions complet. Je soupçonne qu’avec une troisième semaine, nous aurions atteint d’autres cercles, plus lointains que les nôtres. Beaucoup de spectateur·rices nous ont déclaré avoir apprécié le spectacle alors que d’habitude, ils et elles n’aimaient pas le théâtre. Peut-être du fait de l’adresse directe dans une langue somme toute prosaïque.
Ce spectacle touche beaucoup de personnes tout en possédant une forme et une esthétique singulières et radicales. Tant de gens m’en reparlaient longtemps après l’avoir vu ; cela me ravivait à chaque fois l’envie qu’il puisse continuer de vivre et transmettre. Ainsi, j’ai rapidement accepté la proposition d’Esther et j’avais confiance en son instinct. J’ai toujours aimé ses décisions au sein de la Sélection Suisse. En regardant certaines des autres pièces choisies, je vois qu’elle cherche des formes singulières et sincères. Quand elle m’a offert cette possibilité, mon premier réflexe a été « Honore ça. Ne fais pas ta Suisse qui n’ose pas, qui minimise. Assume et honore cette proposition ».
Je trouvais beau qu’un spectacle qui avait été créé au 2.21, un théâtre peu institutionnalisé, avec des conditions financières restreintes, puisse être sélectionné. J’apprécie beaucoup de jouer dans ce lieu de culture qui, d’un point de vue des conditions techniques et du nombre de dates, est excellent. Cependant, en regard à la validation des institutions, il n’est pas l’Arsenic, ni Vidy. Ce fut donc une jolie reconnaissance d’être tout à coup choisie par la Sélection. Et cela confirmait que, pour Esther, l’endroit importe peu. Nous avons un grand besoin de personnes avec cette ouverture et cette confiance dans la culture.
De plus, le geste d’Esther confirme que l’artiste ne doit pas constamment y croire. Que parfois une institution est persuadée à sa place. Et c’est une chance si tout d’un coup, ton travail plaît à quelqu’un qui a du pouvoir. Nous savons ce que sont les sélections. Il s’agit d’histoires d’instants, de chance. Cela n’a pas toujours été le cas pour moi. Il a donc été important d’honorer cette sélection et de faire au mieux. Comme des bons scouts. (Rires)
Aurais-tu tenté Avignon en autoproduction si tu n’avais pas été prise par la Sélection ?
Je ne serais jamais allée à Avignon de moi-même avec cette pièce si singulière. Avignon est d’une intensité telle que je ne me voyais pas du tout m’y lancer dans les conditions du OFF.
Que souhaiterais-tu voir évoluer dans la Sélection Suisse en Avignon?
Ce qui m’a traversé l’esprit, en tant que compagnie suisse romande, serait d’élargir l’espace de diffusion et de créer des ponts, drastiquement absents, avec la suisse allemande. Une Sélection Suisse en Suisse en somme! Ce qui coïnciderait tout à fait avec une des missions de Pro Helvetia qui consiste à soutenir la distribution des pièces suisses dans les autres régions linguistiques du pays.
Avez-vous eu déjà des retombées?
Pas encore. Nous avons reçu un certain nombre de demandes du prix de cession (*prix du spectacle), donc de lieux intéressés. Dans deux jours, je rencontre Esther avec ma chargée de diffusion, Clémence Faravel. Cette dernière s’occupe des relances. Nous verrons. Notamment en rapport avec les tarifs. Ces derniers doivent être adaptés car les prix suisses sont logiquement plus élevés que les français. Nous devrons donc nous confronter à la question de notre limite minimum. Ceci est mon futur chantier.
Et pour terminer, y a-t-il un lieu que tu as particulièrement apprécié dans le festival?
Pour cette édition, j’adorais le lac artificiel du Pontet, proche de notre logement en dehors du festival, où se pratiquait du wakebord. Un havre de paix. J’y prenais un café, j’enregistrais mes notes concernant le spectacle de la veille et je plongeais dans le lac. Le fait qu’il soit complètement déconnecté du festival me procurait beaucoup de bien. Je me demandais d’ailleurs pourquoi ce quartier était à ce point coupé du festival?
A lire aussi

Chloë Lombard : le collectif dans le ventre
” Je crois que je suis très forte pour rebondir sur les idées. Toute seule dans ma cuisine, j’ai du plaisir à travailler mais ça a ses limites. Je pense que personne n’a jamais l’idée du siècle. On ne fait que se piquer des idées et je trouve ça plutôt génial. ”
Entretien signé Marie Lou Félix

Nicolas Rossier – Le plaisir de la curiosité
“Plutôt qu’un rôle, c’est un cheminement. Ce qui m’importe, c’est le parcours que le personnage propose, la façon dont le jeu peut évoluer, ce qu’il provoque. ”
Entretien signé Christine Laville

Alexandra Gentile – Quand l’art du clown se mêle au théâtre
“Avec le clown, il est obligatoire de jouer. Et de traverser ce qu’il y a à traverser. Sillonner les paysages émotionnels, du néant à l’intensité.”
Entretien signé Solange Schifferdecker

Charlotte Filou : Une valse à mille temps
“J’ai l’impression que je peux toucher les gens aussi bien en chantant qu’en parlant, mais que le chemin est moins direct avec un texte parlé. Ça me demande plus de travail et d’introspection. ”
Entretien signé Marie Lou Félix

Adrien Barazzone, les frissons d’un Premier de cordée
« Selon moi, jouer c’est trouver la bonne distance, avec son propos, son personnage et le public. »
Entretien signé Laure Hirsig

Sabine Timoteo, danser vers le dedans
“A l’origine, danser, c’était la joie de me sentir vivante.”
Entretien signé Delphine Horst

Valerio Scamuffa : une poétique de l’échappée
“S’il y a un art fantomatique, c’est peut-être bien le théâtre.”
Entretien signé Marie Lou Félix

Nicolas Müller – L’Art du décalage
« Je me rappelle de ces sensations de liberté et de soulagement durant les premiers spectacles. Cet espace qui s’ouvrait, s’éveillait, demeure la raison pour laquelle je pratique le théâtre aujourd’hui. »
Entretien signé Solange Schifferdecker

Igaëlle Venegas, auto-métamorphoses…
“J’aime l’idée de découvrir quelque chose qui est déjà là, en moi, et de lui permettre de se manifester librement en jouant.”
Entretien signé Stella LO PINTO

Jean Liermier, rencontre entre quatre yeux et deux casquettes
« Si je pars maintenant, ce n’est pas par gaité de cœur ni parce que je suis lassé. Je ne sais même pas ce que je vais faire après. Mon intérêt personnel n’a rien à voir avec cette décision. Je pars parce que je pense que c’est le moment. »
Entretien signé Laure Hirsig

Tatiana Baumgartner à vif et sans fard
“J’ai découvert que j’aimais écrire du théâtre. Les dialogues, les interactions, double sens et sens cachés dans ce que les gens disent. La manipulation derrière le langage.”
Entretien signé Delphine Horst
![Entretien avec Toni Teixeira, créateur costumes – L’Empire des signes [Acte 4]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/12/01-Toni-Teixeira@Michael-Gabriel-1.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Toni Teixeira, créateur costumes – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig

Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (II)
Entretien signé Laure Hirsig

Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (I)
Entretien signé Laure Hirsig

Pierre Monnard, le cinéma et ses multiples ingrédients
Propos recueillis par Sami Kali
![Dorothée Thébert, photographe de plateau – L’Empire des signes [Acte 4]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/09/01-Dorothee-Thebert©Nora-Teylouni-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Dorothée Thébert, photographe de plateau – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig

Cyprien Colombo La vie n’est pas un long flow* tranquille
Article signé Laure Hirsig

Wave Bonardi et Julia Portier : Vertige de l’humour
Entretien signé Marie Lou Félix

Davide Brancato, king of the glam – Ubiquité (acte VII)
Entretien signé Laure Hirsig

Dominique Bourquin, les angles pas droits
Propos recueillis par Delphine Horst

Leon Salazar, le charme de l’ambivalence – Ubiquité (acte VI)
Entretien signé Laure Hirsig

Yvette Théraulaz : un peu, beaucoup ; à l’infini
Propos recueillis par Marie Lou Félix
![Entretien avec Danielle Milovic – L’Empire des signes [Acte 3]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/04/03-Tania-De-Paola-dans-_Le-jardin-de-la-grosse-dame_©Danielle-Milovic.jpg?resize=1000%2C666&ssl=1)
Entretien avec Danielle Milovic – L’Empire des signes [Acte 3]
Entretien signé Laure Hirsig

Arcadi Radeff, la quête instinctive
Propos recueillis par Sami Kali

Maurice Aufair, acteur découvreur
Propos recueillis par Marie-Lou Félix
![Entretien avec Amélie CHÉRUBIN – Ubiquité [Acte 5]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/03/07-_La-Methode-Gronholm_-Cie-Magnifique-Theatre©Guillaume-Perret.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Amélie CHÉRUBIN – Ubiquité [Acte 5]
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec Pierre Audétat – L’Empire des signes [Acte 2]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/02/Pierre-Audeta-2013t©Sebastien-Kohler-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Pierre Audétat – L’Empire des signes [Acte 2]
Entretien signé Laure Hirsig

DIANE ALBASINI : Une Artiste aux Mille Facettes
Entretien signé Anne Thorens

Entretien avec Charlotte Chabbey, l’esprit collectif
Propos recueillis par Sami Kali

Entretien avec CAMILLE MERMET, son pluriel des familles
Propos recueillis par Delphine Horst
![Entretien avec avec Déborah Helle – L’Empire des signes [Acte 1]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/01/Deborah-Helle©Neige-Sanchez-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec avec Déborah Helle – L’Empire des signes [Acte 1]
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec avec Stéphane Rentznik- Ubiquité [Acte IV]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/12/Derrière-les-maux_©PhilippePache.-jpg-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec avec Stéphane Rentznik- Ubiquité [Acte IV]
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec Anna PIERI ZUERCHER – Ubiquité [Acte III]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/12/tournage-série-_Tatort_©Sava-Hlavacek-1.jpg?resize=1000%2C667&ssl=1)
Entretien avec Anna PIERI ZUERCHER – Ubiquité [Acte III]
Entretien signé Laure Hirsig

Djemi Pittet Sané: Respirer à la Racine
Propos recueillis par Marie Lou Félix
![Entretien avec Nastassja Tanner – Ubiquité [Acte II]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/10/01-photo-tirée-du-film-_Dévoilées_-de-Jacob-Berger©DR.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Nastassja Tanner – Ubiquité [Acte II]
Entretien signé Laure Hirsig

Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.

Nicole Borgeat, serial thrilleuse
Portrait de la réalisatrice signé Laure Hirsig,

Entretien avec Marie Ripoll
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec Wissam Arbache ¦ Ubiquité [Acte I]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/08/photo-de-lopéra-_Robert-Le-Diable_©Viktor-Viktorov-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Wissam Arbache ¦ Ubiquité [Acte I]
Entretien signé Laure Hirsig
![Claire Darnalet et Yvan Rihs | Le génie des ingénu.e.s [Acte IV]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/01/projet-Astroland©AlinePaley-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Claire Darnalet et Yvan Rihs | Le génie des ingénu.e.s [Acte IV]
Pour clore le feuilleton Le Génie des ingénu.e.s (IV), la parole passionnée de Claire Darnalet, 21 ans, élève en 1ère année à La Manufacture* […]
![Valeria Bertolotto et Tobia Giorla ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte III]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2022/12/Tobia-Giorla©Dennis-Mader-scaled.jpeg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Valeria Bertolotto et Tobia Giorla ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte III]
Entretiens signés Laure Hirsig

Safi Martin-Yé bouillonne de cultureS
Portrait de la comédienne signé Laure Hirsig,
![Lokman Debabeche et Nathalie Lannuzel ¦ Le génie des ingénu.e.s” [acte II]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2022/09/©Lokman-Debabeche.jpeg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Lokman Debabeche et Nathalie Lannuzel ¦ Le génie des ingénu.e.s” [acte II]
Suite du feuilleton avec Lokman Debabeche. À 23 ans, il démarre sa 3ème année à l’école des Teintureries de Lausanne, enrichi par un parcours personnel qui associe turbulence et sagesse […]

Laurence Perez: Scène suisse, un pont pour danser en Avignon
L’an prochain, Laurence Perez cédera les rênes de « Sélection suisse en Avignon » à Esther Welger-Barboza. En attendant, l’actuelle directrice artistique et exécutive couve une ultime volée dont elle défend avec détermination la singularité.
![Liv Van Thuyne et Serge Martin ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte I]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2022/07/Serge-Martin-photo-du-spectacle-Copies©Olivier-Carrel-2.jpeg?resize=640%2C427&ssl=1)
Liv Van Thuyne et Serge Martin ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte I]
Pour inaugurer ce feuilleton, je m’entretiens avec Liv Van Thuyne, 22 ans, élève de 1ère année à l’école Serge Martin. Malgré son jeune âge, elle s’est déjà frottée au large spectre des arts, sensible aux subtilités qu’offre chacun d’eux. En écho, la magie de la pensée concentrée du maître Serge Martin, qui dit tant en si peu de mots.

Le théâtre-zèbre de Marielle Pinsard
Marielle Pinsard m’a offert mon premier plongeon théâtral. Alors que l’année 2001 allait s’éteindre, Marielle mettait le feu aux poudres avec Comme des couteaux, pièce dont elle était à la fois l’auteure et la metteure en scène.

Michel Vinaver, homme de l’être
Dramaturge et écrivain, mais aussi ancien chef d’entreprise, Michel Vinaver s’est éteint ce 1er mai à 95 ans. En hommage, les extraits d’un entretien accordé il y a quelques années.

Bienvenue dans la 4e dimension de Lucas Savioz! – Rétrofuturiste (VI)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce sixième volet, on traverse l’écran en compagnie de Lucas Savioz.

Faim de séries? La RTS mijote petits et grands plats…
Pandémie ou pas, la loi des séries continue de s’imposer en Suisse comme ailleurs. Entre audaces calculées et contraintes diverses, la RTS trace sa voie dans un univers qui est aussi synonyme d’emplois.

Guillaume Prin, pour un théâtre nomade fait maison – Rétrofuturiste (V)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce cinquième épisode, on embarque à bord du camion-théâtre de Guillaume Prin.

Jean-Louis Johannides, into the wild – Rétrofuturiste (IV)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce 4e volet, on part à la conquête des grands espaces aux côtés de Jean-Louis Johannides.

Alain Borek fait jeu de tout bois – Rétrofuturiste (III)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Ce troisième volet donne la parole au comédien Alain Borek.

Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.

Lucie Zelger ou l’art du contrepoint – Rétrofuturiste (I)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Un voyage des racines jusqu’à l’horizon qu’inaugure la comédienne Lucie Zelger.

Mali Van Valenberg se mêle au vent
Série “J’ai deux amours” (VI). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour cet ultime volet, Laure Hirsig parle écriture avec Mali Van Valenberg.

Alexandra Marcos, voix double
Série “J’ai deux amours” (V). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce nouveau volet, Laure Hirsig suis les “voies” d’Alexandra Marcos.

Paroles de scénaristes : où en est la Suisse?
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.

La Manufacture: la conquête de l’espace
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.

Sébastien Ribaux, l’amour de la psyché
Série “J’ai deux amours” (IV). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile le “double je” de Sébastien Ribaux.

Delphine Lanza, au Pays des merveilles
Série “J’ai deux amours” (III). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile les “multiples palettes” de Delphine Lanza.

Noémie Griess, au plateau et au micro
Série “J’ai deux amours” (II). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce deuxième volet, Laure Hirsig échange avec Noémie Griess sur ce “double jeu”.

Garance La Fata, l’esprit boomerang
Série “J’ai deux amours” (I). Parce que la vie ne s’arrête pas à la scène, certain.e.s comédien.ne.s s’emploient à jouer un rôle bien ancré dans le réel. Pour ce volet inaugural, Laure Hirsig échange avec Garance La Fata sur ce “double jeu”.

Joël Hefti, portrait extérieur
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce sixième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Joël Hefti.

Roberto Garieri, de chair et de mots
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce cinquième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Garieri.

Le parler swing de Roberto Molo
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce quatrième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Molo.

Djamel Bel Ghazi, tempête sous un crâne
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce troisième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Djamel Bel Ghazi.

Aux Teintureries, Nathalie Lannuzel fait “bouger les lignes”
Ouverte en 1997 sous l’impulsion de François Landolt, l’école supérieure de théâtre Les Teintureries à Lausanne cultive l’altérité et valorise l’audace. Rencontre avec sa directrice artistique, Nathalie Lannuzel.

Xavier Loira, dandy cash
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce deuxième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Xavier Loira.

Boubacar Samb, sentinelle sans tabou
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce premier volet d’une série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien d’origine sénégalaise, Boubacar Samp.

Carlo Brandt, l’homme renversé (II)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Second et dernier chapitre d’un entretien sans fard.

Carlo Brandt, l’homme renversé (I)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Premier chapitre.

Julia Perazzini chatouille l’invisible – Fatal(e)s VI
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce dernier volet, elle se laisse entraîner par la comédienne Julia Perazzini dans les limbes de l’enfance.

Isabelle Caillat au coeur de la crise
La comédienne genevoise s’impose en femme de tête et de coeur dans « Cellule de crise », nouvelle série signée Jacob Berger qui nous dévoile les arcanes de l’humanitaire. Entretien à la veille de la diffusion.

Prune Beuchat, comme un ouragan – Fatal(e)s V
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce 5e volet, on croque dans une Prune qui ne compte pas pour des prunes!

Olivier Lafrance, entretien avec un vampire – Fatal(e)s IV
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Le comédien Olivier Lafrance se prête à ce jeu d’ombre.

“Je suis pour les quotas d’auteur.e.s suisses”
A la suite de notre enquête sur le statut de l’auteur.e en Suisse romande, le dramaturge et metteur en scène Julien Mages défend l’idée d’une écriture typiquement “suisse”.

Pour Camille Giacobino, le ciel peut attendre – Fatal(e)s III
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Amour et mort, deux thèmes que fréquente régulièrement Camille Giacobino, comme comédienne ou comme metteuse-en-scène.

Y’a-t-il encore un.e auteur.e dans la salle?
Acteur.trice à la fois central et à part, l’auteur.e d’un spectacle ou d’un film doit composer avec des contraintes qui laissent peu de place à l’ego. Trois d’entre eux/elles nous parlent de leur pratique.

Cédric Leproust, le Garçon et la Mort – Fatal(e)s II
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Au comédien Cédric Leproust de nous entraîner dans le territoire des ombres.

Julia Batinova, l’art de la fougue – Fatal(e)s
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig inaugure une nouvelle série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Première à s’y coller, la comédienne Julia Batinova.

Alain Mudry, colosse au clair de lune
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce sixième “Traversée en solitaire”, on se met sur orbite avec Alain Mudry.

Serge Valletti brise le glas à Avignon
Acteur, auteur, scénariste aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, Serge Valletti a mis du baume aristophanesque sur les plaies du festival avorté. Rencontre.

Arblinda Dauti, la perle noire
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce cinquième “Traversée en solitaire”, on se fait la belle avec Arblinda Dauti.

David Valère, l’homme debout qui met le chaos K.O.
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce quatrième “Traversée en solitaire”, on fend les flots avec David Valère.

Olivia Csiky Trnka, l’extra-terrienne
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce troisième “Traversée en solitaire”, on décolle aux côtés d’Olivia Csiky Trnka.

Raphaël Vachoux, sans peur ni reproche
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce deuxième “Traversée en solitaire”, on embarque aux côtés de Raphaël Vachoux.

Jacques Michel, l’échappée belle
En six décennies de carrière, le comédien a endossé tous les costumes. Acteur dans tous les sens du terme, il a construit une histoire qui déborde la sienne, celle du théâtre romand. Portrait.

Lola Giouse, Miss en tropisme
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude, ses charmes comme sa nocivité dans leur parcours et leur pratique. Pour cette première “Traversée en solitaire”, on largue les amarres avec Lola Giouse.

Françoise Boillat La Dame du lac – Le théâtre dans la peau (VI)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Sixième acte avec la comédienne Françoise Boillat.

Un dernier café avec Michel Piccoli
L’acteur nous a quitté le 12 mai, à l’âge de 94 ans. En guise d’hommage, des extraits inédits d’un entretien accordé à Lionel Chiuch à l’occasion de la tournée de “Minetti”, de Thomas Bernhard.

Julien TSONGAS Préda(c)teur- Le théâtre dans la peau (V)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Cinquième acte avec le comédien Julien Tsongas.

Sandro De Feo Mutant mutin mutique-Le théâtre dans la peau (IV)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Quatrième acte avec le comédien Sandro De Feo.

“Il reste dans la culture une sorte de mépris de classe”
Après un septennat à la tête du GIFF, Emmanuel Cuénod s’apprête à en remettre les clés. Dans un long entretien sans langue de bois, il nous parle du festival genevois et donne quelques coups de griffe à la politique culturelle suisse.

François Revaclier Le spirituel danse l’art – Le théâtre dans la peau (III)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Troisième acte avec le comédien François Revaclier.

Valérie Liengme La créature – Le théâtre dans la peau (II)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Deuxième acte avec la comédienne Valérie Liengme.

Joëlle Fontannaz La magnétique au magnéto – Le théâtre dans la peau (I)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Premier acte avec la comédienne Joëlle Fontannaz.

Monica Budde, la voix libre
D’Andromaque de Racine au personnage de A de Sarah Kane, la comédienne Monica Budde campe des femmes qui, comme elle, ne s’en laissent pas conter. Portrait en toute liberté.

Braqueur de banques!
Alors que la saison 2 de « Quartier des banques » débarque sur les écrans, son réalisateur, Fulvio Bernasconi, nous parle de son rapport aux comédien(ne)s.

“Molière écrit pour sauver les meubles”
Aussi à l’aise chez Molière que chez Ionesco, Michel Bouquet, 94 ans, a voué sa vie aux auteurs. Il les évoque ici.

“L’avantage ici, c’est le Système D”
A la Chaux-de-Fonds, pays des merveilles mécaniques, on croise moins de lapin blanc que de drapeau noir. La comédienne Aurore Faivre brandit celui d’un théâtre qui ose et qui place l’humain au centre.
Toutes les rencontres
Samuel Perthuis – Apprendre à tout faire.
“Si tu veux améliorer le système, à notre niveau, au niveau théâtral, tu dois chercher à le comprendre. .”
Entretien signé Zacharie Jourdain
La jungle du mythique Festival d’Avignon : Esther Welger-Barboza: tisser la présence suisse à Avignon
“L’esprit de la Sélection Suisse en Avignon est généreux. Tu es embarqué·es dans une aventure. ”
Entretien signé Solange Schifferdecker
La jungle du mythique Festival d’Avignon : Marjolaine Minot, l’art en autoproduction.
“J’aime cette cohabitation effervescente de culture, de spectacles, de personnes avec, pour passion commune, le théâtre. Tellement de compagnies enthousiastes ! De plus, en Provence, sous le soleil de l’été, avec cette énergie… quelle beauté à voir et à sentir!”
Entretien signé Solange Schifferdecker
Entretien avec Thomas Hempler, Directeur technique, régisseur général et créateur lumière- L’Empire des signes [Acte 5]
“Ma nature tiraillée entre l’intellectuel, l’artistique et le manuel, a trouvé au théâtre une sorte de fusion magique de ces trois domaines.”
Entretien signé Laure Hirsig
Chloë Lombard : le collectif dans le ventre
” Je crois que je suis très forte pour rebondir sur les idées. Toute seule dans ma cuisine, j’ai du plaisir à travailler mais ça a ses limites. Je pense que personne n’a jamais l’idée du siècle. On ne fait que se piquer des idées et je trouve ça plutôt génial. ”
Entretien signé Marie Lou Félix
Nicolas Rossier – Le plaisir de la curiosité
“Plutôt qu’un rôle, c’est un cheminement. Ce qui m’importe, c’est le parcours que le personnage propose, la façon dont le jeu peut évoluer, ce qu’il provoque. ”
Entretien signé Christine Laville
Alexandra Gentile – Quand l’art du clown se mêle au théâtre
“Avec le clown, il est obligatoire de jouer. Et de traverser ce qu’il y a à traverser. Sillonner les paysages émotionnels, du néant à l’intensité.”
Entretien signé Solange Schifferdecker
Charlotte Filou : Une valse à mille temps
“J’ai l’impression que je peux toucher les gens aussi bien en chantant qu’en parlant, mais que le chemin est moins direct avec un texte parlé. Ça me demande plus de travail et d’introspection. ”
Entretien signé Marie Lou Félix
Adrien Barazzone, les frissons d’un Premier de cordée
« Selon moi, jouer c’est trouver la bonne distance, avec son propos, son personnage et le public. »
Entretien signé Laure Hirsig
Sabine Timoteo, danser vers le dedans
“A l’origine, danser, c’était la joie de me sentir vivante.”
Entretien signé Delphine Horst
Valerio Scamuffa : une poétique de l’échappée
“S’il y a un art fantomatique, c’est peut-être bien le théâtre.”
Entretien signé Marie Lou Félix
Nicolas Müller – L’Art du décalage
« Je me rappelle de ces sensations de liberté et de soulagement durant les premiers spectacles. Cet espace qui s’ouvrait, s’éveillait, demeure la raison pour laquelle je pratique le théâtre aujourd’hui. »
Entretien signé Solange Schifferdecker
Igaëlle Venegas, auto-métamorphoses…
“J’aime l’idée de découvrir quelque chose qui est déjà là, en moi, et de lui permettre de se manifester librement en jouant.”
Entretien signé Stella LO PINTO
Jean Liermier, rencontre entre quatre yeux et deux casquettes
« Si je pars maintenant, ce n’est pas par gaité de cœur ni parce que je suis lassé. Je ne sais même pas ce que je vais faire après. Mon intérêt personnel n’a rien à voir avec cette décision. Je pars parce que je pense que c’est le moment. »
Entretien signé Laure Hirsig
Tatiana Baumgartner à vif et sans fard
“J’ai découvert que j’aimais écrire du théâtre. Les dialogues, les interactions, double sens et sens cachés dans ce que les gens disent. La manipulation derrière le langage.”
Entretien signé Delphine Horst
Entretien avec Toni Teixeira, créateur costumes – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig
Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (II)
Entretien signé Laure Hirsig
Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (I)
Entretien signé Laure Hirsig
Pierre Monnard, le cinéma et ses multiples ingrédients
Propos recueillis par Sami Kali
Dorothée Thébert, photographe de plateau – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig
Cyprien Colombo La vie n’est pas un long flow* tranquille
Article signé Laure Hirsig
Wave Bonardi et Julia Portier : Vertige de l’humour
Entretien signé Marie Lou Félix
Davide Brancato, king of the glam – Ubiquité (acte VII)
Entretien signé Laure Hirsig
Dominique Bourquin, les angles pas droits
Propos recueillis par Delphine Horst
Leon Salazar, le charme de l’ambivalence – Ubiquité (acte VI)
Entretien signé Laure Hirsig
Yvette Théraulaz : un peu, beaucoup ; à l’infini
Propos recueillis par Marie Lou Félix
Entretien avec Danielle Milovic – L’Empire des signes [Acte 3]
Entretien signé Laure Hirsig
Arcadi Radeff, la quête instinctive
Propos recueillis par Sami Kali
Maurice Aufair, acteur découvreur
Propos recueillis par Marie-Lou Félix
Entretien avec Amélie CHÉRUBIN – Ubiquité [Acte 5]
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec Pierre Audétat – L’Empire des signes [Acte 2]
Entretien signé Laure Hirsig
DIANE ALBASINI : Une Artiste aux Mille Facettes
Entretien signé Anne Thorens
Entretien avec Charlotte Chabbey, l’esprit collectif
Propos recueillis par Sami Kali
Entretien avec CAMILLE MERMET, son pluriel des familles
Propos recueillis par Delphine Horst
Entretien avec avec Déborah Helle – L’Empire des signes [Acte 1]
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec avec Stéphane Rentznik- Ubiquité [Acte IV]
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec Anna PIERI ZUERCHER – Ubiquité [Acte III]
Entretien signé Laure Hirsig
Djemi Pittet Sané: Respirer à la Racine
Propos recueillis par Marie Lou Félix
Entretien avec Nastassja Tanner – Ubiquité [Acte II]
Entretien signé Laure Hirsig
Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.
Nicole Borgeat, serial thrilleuse
Portrait de la réalisatrice signé Laure Hirsig,
Entretien avec Marie Ripoll
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec Wissam Arbache ¦ Ubiquité [Acte I]
Entretien signé Laure Hirsig
Claire Darnalet et Yvan Rihs | Le génie des ingénu.e.s [Acte IV]
Pour clore le feuilleton Le Génie des ingénu.e.s (IV), la parole passionnée de Claire Darnalet, 21 ans, élève en 1ère année à La Manufacture* […]
Valeria Bertolotto et Tobia Giorla ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte III]
Entretiens signés Laure Hirsig
Safi Martin-Yé bouillonne de cultureS
Portrait de la comédienne signé Laure Hirsig,
Lokman Debabeche et Nathalie Lannuzel ¦ Le génie des ingénu.e.s” [acte II]
Suite du feuilleton avec Lokman Debabeche. À 23 ans, il démarre sa 3ème année à l’école des Teintureries de Lausanne, enrichi par un parcours personnel qui associe turbulence et sagesse […]
Laurence Perez: Scène suisse, un pont pour danser en Avignon
L’an prochain, Laurence Perez cédera les rênes de « Sélection suisse en Avignon » à Esther Welger-Barboza. En attendant, l’actuelle directrice artistique et exécutive couve une ultime volée dont elle défend avec détermination la singularité.
Liv Van Thuyne et Serge Martin ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte I]
Pour inaugurer ce feuilleton, je m’entretiens avec Liv Van Thuyne, 22 ans, élève de 1ère année à l’école Serge Martin. Malgré son jeune âge, elle s’est déjà frottée au large spectre des arts, sensible aux subtilités qu’offre chacun d’eux. En écho, la magie de la pensée concentrée du maître Serge Martin, qui dit tant en si peu de mots.
Le théâtre-zèbre de Marielle Pinsard
Marielle Pinsard m’a offert mon premier plongeon théâtral. Alors que l’année 2001 allait s’éteindre, Marielle mettait le feu aux poudres avec Comme des couteaux, pièce dont elle était à la fois l’auteure et la metteure en scène.
Michel Vinaver, homme de l’être
Dramaturge et écrivain, mais aussi ancien chef d’entreprise, Michel Vinaver s’est éteint ce 1er mai à 95 ans. En hommage, les extraits d’un entretien accordé il y a quelques années.
Bienvenue dans la 4e dimension de Lucas Savioz! – Rétrofuturiste (VI)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce sixième volet, on traverse l’écran en compagnie de Lucas Savioz.
Faim de séries? La RTS mijote petits et grands plats…
Pandémie ou pas, la loi des séries continue de s’imposer en Suisse comme ailleurs. Entre audaces calculées et contraintes diverses, la RTS trace sa voie dans un univers qui est aussi synonyme d’emplois.
Guillaume Prin, pour un théâtre nomade fait maison – Rétrofuturiste (V)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce cinquième épisode, on embarque à bord du camion-théâtre de Guillaume Prin.
Jean-Louis Johannides, into the wild – Rétrofuturiste (IV)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce 4e volet, on part à la conquête des grands espaces aux côtés de Jean-Louis Johannides.
Alain Borek fait jeu de tout bois – Rétrofuturiste (III)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Ce troisième volet donne la parole au comédien Alain Borek.
Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.
Lucie Zelger ou l’art du contrepoint – Rétrofuturiste (I)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Un voyage des racines jusqu’à l’horizon qu’inaugure la comédienne Lucie Zelger.
Mali Van Valenberg se mêle au vent
Série “J’ai deux amours” (VI). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour cet ultime volet, Laure Hirsig parle écriture avec Mali Van Valenberg.
Alexandra Marcos, voix double
Série “J’ai deux amours” (V). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce nouveau volet, Laure Hirsig suis les “voies” d’Alexandra Marcos.
Paroles de scénaristes : où en est la Suisse?
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.
La Manufacture: la conquête de l’espace
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.
Sébastien Ribaux, l’amour de la psyché
Série “J’ai deux amours” (IV). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile le “double je” de Sébastien Ribaux.
Delphine Lanza, au Pays des merveilles
Série “J’ai deux amours” (III). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile les “multiples palettes” de Delphine Lanza.
Noémie Griess, au plateau et au micro
Série “J’ai deux amours” (II). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce deuxième volet, Laure Hirsig échange avec Noémie Griess sur ce “double jeu”.
Garance La Fata, l’esprit boomerang
Série “J’ai deux amours” (I). Parce que la vie ne s’arrête pas à la scène, certain.e.s comédien.ne.s s’emploient à jouer un rôle bien ancré dans le réel. Pour ce volet inaugural, Laure Hirsig échange avec Garance La Fata sur ce “double jeu”.
Joël Hefti, portrait extérieur
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce sixième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Joël Hefti.
Roberto Garieri, de chair et de mots
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce cinquième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Garieri.
Le parler swing de Roberto Molo
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce quatrième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Molo.
Djamel Bel Ghazi, tempête sous un crâne
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce troisième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Djamel Bel Ghazi.
Aux Teintureries, Nathalie Lannuzel fait “bouger les lignes”
Ouverte en 1997 sous l’impulsion de François Landolt, l’école supérieure de théâtre Les Teintureries à Lausanne cultive l’altérité et valorise l’audace. Rencontre avec sa directrice artistique, Nathalie Lannuzel.
Xavier Loira, dandy cash
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce deuxième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Xavier Loira.
Boubacar Samb, sentinelle sans tabou
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce premier volet d’une série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien d’origine sénégalaise, Boubacar Samp.
Carlo Brandt, l’homme renversé (II)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Second et dernier chapitre d’un entretien sans fard.
Carlo Brandt, l’homme renversé (I)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Premier chapitre.
Julia Perazzini chatouille l’invisible – Fatal(e)s VI
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce dernier volet, elle se laisse entraîner par la comédienne Julia Perazzini dans les limbes de l’enfance.
Isabelle Caillat au coeur de la crise
La comédienne genevoise s’impose en femme de tête et de coeur dans « Cellule de crise », nouvelle série signée Jacob Berger qui nous dévoile les arcanes de l’humanitaire. Entretien à la veille de la diffusion.
Prune Beuchat, comme un ouragan – Fatal(e)s V
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce 5e volet, on croque dans une Prune qui ne compte pas pour des prunes!
Olivier Lafrance, entretien avec un vampire – Fatal(e)s IV
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Le comédien Olivier Lafrance se prête à ce jeu d’ombre.
“Je suis pour les quotas d’auteur.e.s suisses”
A la suite de notre enquête sur le statut de l’auteur.e en Suisse romande, le dramaturge et metteur en scène Julien Mages défend l’idée d’une écriture typiquement “suisse”.
Pour Camille Giacobino, le ciel peut attendre – Fatal(e)s III
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Amour et mort, deux thèmes que fréquente régulièrement Camille Giacobino, comme comédienne ou comme metteuse-en-scène.
Y’a-t-il encore un.e auteur.e dans la salle?
Acteur.trice à la fois central et à part, l’auteur.e d’un spectacle ou d’un film doit composer avec des contraintes qui laissent peu de place à l’ego. Trois d’entre eux/elles nous parlent de leur pratique.
Cédric Leproust, le Garçon et la Mort – Fatal(e)s II
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Au comédien Cédric Leproust de nous entraîner dans le territoire des ombres.
Julia Batinova, l’art de la fougue – Fatal(e)s
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig inaugure une nouvelle série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Première à s’y coller, la comédienne Julia Batinova.
Alain Mudry, colosse au clair de lune
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce sixième “Traversée en solitaire”, on se met sur orbite avec Alain Mudry.
Serge Valletti brise le glas à Avignon
Acteur, auteur, scénariste aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, Serge Valletti a mis du baume aristophanesque sur les plaies du festival avorté. Rencontre.
Arblinda Dauti, la perle noire
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce cinquième “Traversée en solitaire”, on se fait la belle avec Arblinda Dauti.
David Valère, l’homme debout qui met le chaos K.O.
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce quatrième “Traversée en solitaire”, on fend les flots avec David Valère.
Olivia Csiky Trnka, l’extra-terrienne
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce troisième “Traversée en solitaire”, on décolle aux côtés d’Olivia Csiky Trnka.
Raphaël Vachoux, sans peur ni reproche
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce deuxième “Traversée en solitaire”, on embarque aux côtés de Raphaël Vachoux.
Jacques Michel, l’échappée belle
En six décennies de carrière, le comédien a endossé tous les costumes. Acteur dans tous les sens du terme, il a construit une histoire qui déborde la sienne, celle du théâtre romand. Portrait.
Lola Giouse, Miss en tropisme
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude, ses charmes comme sa nocivité dans leur parcours et leur pratique. Pour cette première “Traversée en solitaire”, on largue les amarres avec Lola Giouse.
Françoise Boillat La Dame du lac – Le théâtre dans la peau (VI)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Sixième acte avec la comédienne Françoise Boillat.
Un dernier café avec Michel Piccoli
L’acteur nous a quitté le 12 mai, à l’âge de 94 ans. En guise d’hommage, des extraits inédits d’un entretien accordé à Lionel Chiuch à l’occasion de la tournée de “Minetti”, de Thomas Bernhard.
Julien TSONGAS Préda(c)teur- Le théâtre dans la peau (V)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Cinquième acte avec le comédien Julien Tsongas.
Sandro De Feo Mutant mutin mutique-Le théâtre dans la peau (IV)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Quatrième acte avec le comédien Sandro De Feo.
“Il reste dans la culture une sorte de mépris de classe”
Après un septennat à la tête du GIFF, Emmanuel Cuénod s’apprête à en remettre les clés. Dans un long entretien sans langue de bois, il nous parle du festival genevois et donne quelques coups de griffe à la politique culturelle suisse.
François Revaclier Le spirituel danse l’art – Le théâtre dans la peau (III)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Troisième acte avec le comédien François Revaclier.
Valérie Liengme La créature – Le théâtre dans la peau (II)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Deuxième acte avec la comédienne Valérie Liengme.
Joëlle Fontannaz La magnétique au magnéto – Le théâtre dans la peau (I)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Premier acte avec la comédienne Joëlle Fontannaz.
Monica Budde, la voix libre
D’Andromaque de Racine au personnage de A de Sarah Kane, la comédienne Monica Budde campe des femmes qui, comme elle, ne s’en laissent pas conter. Portrait en toute liberté.
Braqueur de banques!
Alors que la saison 2 de « Quartier des banques » débarque sur les écrans, son réalisateur, Fulvio Bernasconi, nous parle de son rapport aux comédien(ne)s.
“Molière écrit pour sauver les meubles”
Aussi à l’aise chez Molière que chez Ionesco, Michel Bouquet, 94 ans, a voué sa vie aux auteurs. Il les évoque ici.
“L’avantage ici, c’est le Système D”
A la Chaux-de-Fonds, pays des merveilles mécaniques, on croise moins de lapin blanc que de drapeau noir. La comédienne Aurore Faivre brandit celui d’un théâtre qui ose et qui place l’humain au centre.
“Il faut rester punk dans l’âme” – Cherchez l’enfant avec Fréderic Polier
Acteur, metteur en scène, raconteur d’histoires et tricoteur de fictions, Frédéric Polier continue de croiser le fer pour un théâtre généreux et rebelle.
Daniel Vouillamoz: “Nous vivons l’époque du théâtre selfie”
Avec l’amour, la haine n’est jamais très loin. Acteur, auteur, metteur en scène mais aussi musicien, Daniel Vouillamoz effeuille volontiers la marguerite quand il parle de théâtre, cet « art pathétiquement inutile et pourtant essentiel ».
Gilles Tschudi: “C’est vrai, je ne connais pas de barrière”
Acteur puissant et subtil, Gilles Tschudi n’hésite pas à se mettre à nu, comme dans « Souterrainblues », mis en scène par Maya Bösch il y a près de dix ans au Grütli. Mais l’homme dévoile volontiers aussi ce qui « l’agit » et dresse ici une véritable métaphysique du jeu.
Jean-Luc Borgeat: “Le personnage, je ne sais pas ce que c’est”
Acteur, metteur en scène, écrivain, Jean-Luc Borgeat ne boude la parole que lorsqu’il se pose au bord d’un cours d’eau pour pêcher à la mouche.
Théâtre des Osses, théâtre de chair
On prend les chemins de traverse jusqu’à Givisiez pour y rencontrer Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. Leur nouvelle saison regarde la planète en face.
Sarah Marcuse: Tribulations avignonnaises
En 2018, la comédienne et metteure en scène genevoise Sarah Marcuse s’est frottée au Festival Off. Elle en rapporte un témoignage fort que nous reproduisons ici avec son aimable autorisation.
Carole Epiney, névrosée à temps partiel
Elle était impeccable dans « Les névroses sexuelles de nos parents ». La valaisanne Carole Epiney affronte les aléas de la vie de comédienne romande avec une belle énergie.
On ne peut pas être aimé par tout le monde
Difficile, l’exercice du casting? Pour comedien.ch, Nathalie Chéron, trente ans à chercher la perle rare, livre quelques « trucs » pour faire baisser la pression.
Il y a plus de compagnies que de films
Critique à la Tribune de Genève, Pascal Gavillet est un habitué du cinéma suisse, dont il connait bien les mécanismes. On fait le point avec lui.
Serge Martin cultive l’esprit d’équipe
Pour celui qui a créé sa propre école à Genève il y a maintenant plus de 30 ans, le théâtre reste une histoire de partage.