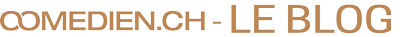Jean Liermier, rencontre entre quatre yeux et deux casquettes
Dans le brouhaha d’un wagon saturé d’effluves douteux, je regarde distraitement s’écouler le fil d’actualité d’un réseau social. Une enfant-zombie marche sur les ruines d’une ville en appelant sa mère / une fashionista bas de gamme se tartine de gelée anti-rides en gros plan / un chat japonais fait de la balançoire ; ce zapping arbitraire entrechoque tragique, superficiel et absurde, déversant avec l’obscénité d’un étron médiatique les miasmes hétéroclites d’un monde en décomposition. Scroller sur l’actu, un infime mouvement de pouce sans conséquence sur un écran sans relief, qui déclenche pourtant en moi un tsunami de lassitude.
Dans ce maelström, surgit soudain un sourire providentiel qui m’extrait de ma torpeur, me ramenant ici et maintenant. Le 1er octobre dernier, Jean Liermier annonçait son départ du Théâtre de Carouge. Le Temps, La Tribune de Genève, la Radio Suisse Romande lâchent la nouvelle les uns après les autres. Un léger vertige me gagne, comme si certaines personnes endossaient tacitement le rôle de piliers et lorsqu’ils bougent, ce sont toutes les fondations qui tremblent. Le départ de Jean Liermier de Carouge laisse incrédule. Il en a pris la direction il y a 18 ans. 18 ans… vraiment ? La maison a atteint l’âge de la majorité et doit poursuivre sa croissance accompagnée par un autre capitaine, estime-t-il.
Le futur ex-Directeur de ce haut-lieu de création accepte de répondre à une volée de questions, qui vont et viennent entre ses deux casquettes de Metteur en scène et de Directeur d’institution.
Article signé Laure Hirsig

Jean Liermier ©Carole Parodi
Comment accompagner l’acteur.ice dans la construction du personnage ?
C’est une démarche à la fois empirique et concrète, pour laquelle il faut faire preuve de bienveillance et d’honnêteté. Prenons l’exemple, dans La Vie que je t’ai donnée de Pirandello, du personnage de la mère, Donna Anna. Elle est décrite par les autres comme taiseuse et solitaire, alors que paradoxalement elle a énormément de texte… étrange pour un personnage qui ne parle pas… En creusant, j’ai compris que c’était la 1ère fois de sa vie qu’Anna tentait de s’expliquer. Nous avons découvert qu’à l’intérieur même des répliques, elle se corrige, se trompe, se reprend pour préciser sa pensée en mouvement avec d’autres mots. Mon rôle a notamment consisté à minutieusement aider la magnifique comédienne Clotilde Mollet à sentir ces mouvements, en pointant les contradictions, les moments d’euphorie ou de désespérance face à l’incompréhension des autres. Et pourtant il n’y avait rien d’intellectuel, tout était de l’ordre du sensible et du charnel. Dans mon dernier spectacle, La Crise de Coline Serreau, tous les personnages sont pétris de contradictions. Du coup, d’une scène à l’autre, ils apparaissent comme différents, alors que ce sont les mêmes. Par exemple, la sœur de Victor, jouée par Camille Figuereo, est capable de mots terribles à l’encontre de sa mère (Brigitte Rosset) lorsque celle-ci annonce qu’elle quitte le père pour partir avec un autre homme. Quelques scènes plus tard, on la retrouve chez elle, chassant son propre fiancé (Baptiste Gilliéron), hurlant son envie d’être seule, revendiquant sa liberté individuelle et affirmant son refus catégorique du mariage. Quoiqu’elle en dise, elle est vraiment la fille de sa mère. Nous sommes faits de mouvements contradictoires, de failles, de doutes. Mais pour rendre compte de cette vie-là, si proche de nous, il faut s’armer de patience, d’écoute et de persévérance, et ne pas tomber dans les clichés ou les aprioris.

“La Crise” de Coline Serreau, avec Romain Daroles et Simon Romang©Carole Parodi

“Cyrano de Bergerac” d’Edmond Rostand, avec Yann Philipona, Gilles Privat et Lola Riccaboni©Mario Del Curto
Dans La Crise, le personnage de Victor, interprété par Simon Romang, traverse une série d’épreuves. Sa vie déraille au sens propre, le contraignant à un pas de côté involontaire. N’est-pas finalement l’addition de ces crises qui lui donnera l’opportunité de changer ?
Victor parcourt bien malgré lui un chemin initiatique. Je ne sais pas si la société l’a rendu crétin ou s’il l’a toujours été, mais il est responsable de l’échec de son couple, et professionnellement, il s’est servi d’un système qui l’expulsera à son tour sans le moindre état d’âme. Ses ruptures professionnelles et familiales provoquent des rencontres incongrues, notamment avec Michou qu’incarne Romain Daroles, puis Djamila que joue – entre autres personnages – Dominique Gubser. Les crises tissent d’improbables liens entre des personnages dépassés par les situations. Sa rencontre avec Djamila, alors sur le seuil de la mort et qui lui livre un grand secret, va redonner un sens à sa vie, à travers l’altérité. Sa reconstruction passera par la mise en pratique de cette découverte, notamment en prenant Michou sous son aile. Dans ce mouvement intime, ce n’est plus le statut social qui régit son rapport à l’autre mais ce qu’il est en tant qu’être humain. Il a fallu cette cascade de crises pour qu’il comprenne. Pour en rendre compte, il faut que l’acteur puisse reproduire chaque soir sa partition, il doit connaitre intimement de quoi les choses sont faites, tout en conservant une part de naïveté, de mystère.
Pourquoi avoir choisi ce texte ?
Cette saison, j’ai ressenti le besoin de prendre un peu de distance avec les classiques. Tu vois la bibliothèque derrière toi ? Au milieu de tous ces livres, c’est un peu comme si La Crise m’avait appelé. Coline Serreau est à la fois une grande réalisatrice et auteure de théâtre. Benno Besson la qualifiait d’Aristophane d’aujourd’hui. Elle possède une science de l’agencement des mots et pousse les personnages dans leurs retranchements, en les plongeant dans des situations extrêmes. Elle parvient à provoquer le rire tout en regardant notre monde les yeux dans les yeux. J’avais envie d’empoigner cela : La Crise s’est imposée, pour son universalité. Sur chaque sujet dont elle s’empare, Coline Serreau parvient à tisser la grande et la petite histoire en s’appuyant sur nos paradoxes humains, sans juger. Le personnage du député Laville, interprété par François Nadin entre autres rôles, se sert de la lutte contre le racisme principalement pour soigner son image, alors que ce n’est évidemment pas une question d’image mais bel et bien un problème de fond. Le personnage est incapable de traiter le fond. Il reste coincé dans des chocs de posture que l’on retrouve à plein d’autres endroits de la société, y compris dans nos métiers. Comme une chimiste, Coline Serreau catalyse les crises, et, d’explosions en implosions, nous renvoie à nous-mêmes.

“Le Malade imaginaire” de Molière, avec Sabrina Martin, Madeleine Assas et Gilles Privat@Carole Parodi
Mes choix de pièces ne sont jamais formels. Mais le fil rouge c’est la nécessité d’une écriture forte, d’un choc de lecture.
On retrouve des thématiques communes dans les textes que vous montez, qu’ils soient classiques ou contemporains. Entre autres, le rapport de classes, le lien entre médecine, croyances et science, le pouvoir arbitraire des pères, le changement d’identité, volontaire ou subi. S’agit-il de thèmes choisis consciemment ou leur récurrence n’est-elle pas consciente ? Vos choix sont-ils guidés par une vision de l’humanité à partager par le biais de la scène ou par des coups de cœur pour la qualité formelle et stylistique d’une écriture ?
Mes choix ne sont jamais formels. Mais le fil rouge c’est la nécessité d’une écriture forte, d’un choc de lecture. Lorsque je monte un auteur du 17ème ou du 18ème siècle, le texte est en français, mais un français qui n’est plus tout à fait le nôtre. Je dois amener les interprètes à décrypter cette “langue”, à comprendre exactement de quoi elle parle, afin de ne pas juste dire des mots. L’acteur se mettra à parler véritablement cette langue-là lorsqu’il en aura saisi les enjeux. Cette compréhension de l’interprète est nécessaire pour qu’à son tour, le public puisse être comme frappé par « l’esprit saint » et qu’il perçoive réellement, profondément, les enjeux véhiculés par le texte. Par contraste avec des écritures plus anciennes, la langue de Coline Serreau me semblait très accessible. En la travaillant, j’ai réalisé à quel point elle était construite, savante. On sent qu’elle est comédienne et qu’elle compose une partition musicale induisant un rythme, un phrasé et un rapport spécial à la diction, qu’elle sculpte avec la ponctuation. Comme chez d’autres, les virgules, les points ne sont jamais inscrits au hasard. Parfois, elle enchaîne une longue réplique sans aucune ponctuation, par moment elle fragmente la parole. Au-delà des mots, l’un des défis singuliers que pose La Crise réside dans le fait que la matière originelle est un scenario de cinéma, régi par d’autres outils que les nôtres. Dans l’adaptation théâtrale, il y a 40 changements de décors et 30 personnages, pour lesquels l’éditeur n’a pas souhaité indiquer la répartition imaginée par Coline et son fils Samuel Tasinaje. Il a donc fallu tisser nos propres cohérences dans les partitions des 8 interprètes. 8 pour 30 rôles ! Je savais pour le coup que nous allions devoir entrer dans une théâtralité qui nous permettrait de nous distancier du film, de trouver notre liberté. Le scénographe Rudy Sabounghi a imaginé des espaces dessinés, commandés au peintre Louis Lavedan. Ces dessins étaient projetés, afin que les lieux, un peu comme avec des panneaux brechtiens, soient immédiatement identifiables et nous permettent de rester en tension pour apprécier le jeu sur un plateau quasi nu.

répétitions “La fausse suivante” de Marivaux, avec Brigitte Rosset et Rébecca Balestra©Carole Parodi
Votre théâtre va vite, un rythme cohérent avec celui qui est le vôtre. Travaillez-vous techniquement la rapidité avec les acteurs pour leur transmettre cette cadence ? Votre pâte rythmique est-elle l’un des éléments qui les met ensemble ? Et enfin, pensez-vous qu’il faut allez vite car il y a urgence à vivre ?
Il n’y a pas une vérité, tout est relatif, mais oui, j’ai conscience que le temps est compté. Le temps, les rites, les rythmes, sont fondamentaux au théâtre. Peut-être est-ce ma manière d’appréhender le deuil, la fin. Le théâtre est une succession de fins avec lesquelles il faut vivre. Fin d’une représentation, fin d’un spectacle… Je ne dis pas que le théâtre adoucit l’idée de la mort mais il nous amène à la côtoyer et vivre avec. C’est presque une philosophie.
Je ne dis pas que le théâtre adoucit l’idée de la mort mais il nous amène à la côtoyer et vivre avec. C’est presque une philosophie.
Le théâtre, c’est aussi rejouer plusieurs fois le présent, comme un refus d’aller directement à la fin, comme une artificialisation du temps qui refuse de s’écouler « normalement ».
Le théâtre, comme la vie est fait de saisons. Je suis attentif au côté organique et cyclique de notre métier. Un écrit théorique de Kleist De l’élaboration progressive des idées par la parole a beaucoup compté pour moi, notamment lorsque j’ai abordé Musset. Grâce au son d’une voix, les mots sont la concrétisation physique et matérielle de la pensée. Au théâtre, nous aurions tendance à ralentir pour montrer que l’on pense. Or, le théâtre est un lieu de nœuds et de conflits. Dans ces situations, le cerveau va très vite. Lorsque je faisais mes spectacles au collège avec mes camarades, j’essayais déjà par tous les moyens de les faire courir, de les mettre dans des positions pas possibles pour que le texte sonne autrement, pour qu’il vive et ne soit surtout pas asséné. Je déteste les donneurs de leçon. Si l’on veut injecter un peu de fulgurance, il faut cette vivacité-là.
Le mordant, le cassant et l’incisif de l’écriture de Coline Serreau passent par la rapidité, qui tord le cou à toute psychologie.
La vivacité de la parole est-elle le signe d’une parole courageuse ?
Je crois au pouvoir de la fiction. Raconter des histoires peut paraître ringard et il existe aujourd’hui d’autres formes de théâtre formidables. Mais pour moi, la fiction reste la force – à l’instar du symbole en psychanalyse – qui permet la catharsis. Elle est constitutive de l’être humain et représente un art en soi, car soyons juste, il est extrêmement ardu de bien raconter une histoire. La mise en scène est un aller-retour permanent entre d’infinis détails et une vision méta. C’est assez sportif, parfois épuisant pour l’acteur. Cette somme de travail colossale trouvera sa résolution avec le public. Durant les répétitions de La Crise, l’équipe s’est questionnée : peut-on tout jouer ? Peut-on tout dire ? Ayons le courage et la confiance de chercher des solutions de théâtre, de ne pas renoncer à la complexité, même si parfois cela peut paraitre sulfureux ! Donnons une chance à la fiction, tant que cela fait sens et n’altère pas l’intégrité des artistes. Couper, simplifier ce qui dérange, ce qui frotte ou grince, revient à ne pas faire confiance au public, à prémâcher son travail. Je respecte trop l’intelligence collective d’une salle pour cela. Laissons les gens puiser ce dont ils ont besoin.

“On ne badine pas avec l’amour” d’Alfred de Musset, avec Adeline d’Hermy et Cyril Metzger@Carole Parodi

“La fausse suivante” de Marivaux, avec Brigitte Rosset et Lola Giouse©Lauren Pasche
C’EST LE PLATEAU QUI DIRIGE ! Tout se construit autour de la création, des artistes qui sont en travail et du public.
Lorsque vous êtes nommé à la tête du Théâtre de Carouge en 2008, il s’agit d’une 1ère expérience de direction de théâtre. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans cette aventure tentaculaire ?
Ce qui m’a le plus surpris ? Que mon postulat de départ fonctionne. J’ai toujours considéré que je dirigerais cette maison comme je fais une mise en scène. L’équipe d’origine a été conçue exactement comme une distribution ; chaque personne étant pensée à chaque endroit. Comme tout était empirique, je pariais sur des personnalités en imaginant qu’elles allaient devoir travailler ensemble. J’ai essayé de mobiliser les gens de façon à ce que se développe en parallèle de leur mission respective, la curiosité de regarder par-dessus l’épaule de l’autre. La seule injonction : C’EST LE PLATEAU QUI DIRIGE ! Tout se construit autour de la création, des artistes qui sont en travail et du public. Tout est réfléchi pour favoriser la rencontre entre la salle et la scène, dès l’arrivée sur la place, dans le foyer, le restaurant. Vous le savez c’est fragile, il ne faut pas grand-chose pour ruiner bêtement des mois de travail : un mauvais accueil, un foyer sans hospitalité, une inattention et les personnes rentrent dans la salle avec les chakras tout fermés. Et après on galère… Autant l’éviter.
Quand je vois la somme de cerveaux investis dans la création d’une pièce ou dans le projet de direction du Théâtre de Carouge, c’est ahurissant. Si l’on parvient à stimuler l’équipe, chacun.e tire sur le même fil, à sa façon. Personnellement, je n’impose pas les choses. J’essaye de convaincre avec une vision, de donner un cap. J’ai besoin de personnalités fortes au service d’un projet collectif.
Diriger un lieu implique d’investir des forces et des moyens – en partie publics – dans la programmation. Mon devoir consiste à défendre 6 ou 7 spectacles par saison. Cela peut paraitre peu, mais je trouve bien que le théâtre soit quelque chose de rare, une aventure collective humaine qui se travaille sur un temps long, nécessaire pour que se tissent des liens entre les équipes artistiques et celle du théâtre. Les séries permettent le bouche-à-oreille. Peu de lieux programment pendant 4 à 5 semaines en grande salle ou 2 mois en petite salle. Cette saison nous dépassons les 60 000 personnes, 11 500 billets ont été vendus pour les représentations de La Crise à Carouge. Bien entendu, les théâtres n’ont pas tous les mêmes objectifs et c’est très bien ainsi. Certains accompagnent un maximum de spectacles qui se jouent quelques soirs. Mais il est fondamental qu’un modèle comme le Théâtre de Carouge existe et perdure dans le paysage.
Dans ma lettre d’intention en 2007, figuraient quatre points. Le répertoire, le public, le rayonnement de l’institution sur Genève, en Suisse romande et dans la francophonie et enfin, renouveler l’infrastructure. C’était ambitieux, parfois titanesque, mais j’ai eu la chance d’être accompagné par une garde rapprochée hors du commun : Christophe de la Harpe, directeur technique, David Junod, administrateur. Et naturellement toute l’équipe du Théâtre qui est passionnément aimante.
Si je pars maintenant, ce n’est pas par gaité de cœur ni parce que je suis lassé. Je ne sais même pas ce que je vais faire après. Mon intérêt personnel n’a rien à voir avec cette décision. Je pars parce que je pense que c’est le moment.
Vous n’aurez pas profité longtemps du nouveau théâtre.
Je n’ai pas mené ce chantier pour moi. J’avais la conviction que si nous ne le menions pas, le Théâtre de Carouge était mort, je n’avais donc pas le choix. Il aurait été paradoxal de se battre pour que le théâtre marche aussi bien puis le laisser disparaître. Je ne voulais pas être le fossoyeur du Théâtre de Carouge ! Cela m’a donné de la force.
Si je pars maintenant, ce n’est pas par gaité de cœur, ni parce que je suis lassé ou fatigué. Je ne sais même pas ce que je vais faire après. Mon intérêt personnel n’a rien à voir avec cette décision.
Je pars parce que je pense que c’est le moment. Le public afflue, le nouveau théâtre est sublime, l’équipe extraordinaire. Je me suis toujours considéré comme un lièvre. Je cours à fond puis je me mets sur la touche pour que les autres prennent le relai et battent les records. Préparer le terrain et faire en sorte que la situation soit saine pour celles et ceux qui viendront, me comble, sachant que nous n’en sommes pas à un point d’arrivée, mais désormais à un point de départ.
La direction d’un théâtre de création implique de se projeter sur des années. Je ne vais pas rempiler pour 10 ans, ce ne serait pas sain ! Après 18 ans de direction, je ne représente pas l’avenir du théâtre de Carouge, il faut être lucide. C’est la vie, il faut juste le reconnaître et savoir prendre les décisions au bon moment. Le prochain directeur y insufflera autre chose, nourrira l’équipe autrement, avec son énergie, sa voix, sa sensibilité et rencontrera le public, je n’en doute pas.
L’équipe est la plus grande force du plus beau Théâtre de Carouge du monde !

Jean Liermier©Carole Parodi
Qu’est-ce qui vous a le plus pesé durant votre mandat de Direction ?
Dire non… Je me retrouve régulièrement face à des artistes dans le besoin, et momentanément, je ne peux rien faire pour eux. La précarité du monde dans lequel nous vivons mais aussi du milieu du spectacle, est éprouvante. C’est terrible de dire non à des gens que vous respectez, qui rêvent à un projet et de ne pas pouvoir répondre à leur désir. On voudrait toujours faire plus. Mais j’ai choisi d’être là, on m’a nommé pour un programme que j’ai développé, et je l’assume. Il y a des projets que je trouve sincèrement enthousiasmants mais pour lesquels je pense que Carouge n’est pas le bon écrin, ou que ce n’est pas le moment propice. C’est comme un mobile de Calder, il existe un point d’équilibre complexe à trouver.
Le fait de reconstruire le nouveau théâtre là où se trouvait l’ancienne salle François Simon, là où il y avait déjà eu du théâtre, a dû réveiller des fantômes bienveillants.
Je perçois chez vous un fort sens de la mission, une forme de foi en quelque chose de plus grand que vous.
Comme Jean Villar, je pense que l’institution est plus forte que moi. Le Théâtre de Carouge a une histoire. Il était là avant moi et sera là après moi. Je n’en suis que temporairement le Directeur. Alors oui, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi. Ce théâtre, j’en ai fait une affaire de vie ou de mort, pas les miennes, mais celles de l’institution dont la charge m’a été confiée. Par exemple, après le référendum remporté pour la reconstruction du Théâtre en 2017, les autorités nous recommandaient de fermer pendant 3 ans durant les travaux. J’ai dit non, que nous allions construire un théâtre éphémère, car il était hors de question que je licencie mon équipe et que nous ouvrions 3 années plus tard, sans plus personne… Du coup nous devenons Maître d’ouvrage de ce qui deviendra La Cuisine*, nous contractons un emprunt, créons un consortium d’entreprises ; c’était juste cinglé mais après des mois de travail, d’hypothèses, j’avais la conviction que c’était le chemin juste. Le Conseil de Fondation, et surtout David Junod et Christophe de La Harpe ont été indispensables dans cette folle entreprise. Aujourd’hui, je peux dire que notre part d’inconscience était vitale, notamment pour convaincre les autorités de lancer un concours d’architecture très vite après mon arrivée.
Tout est devenu récit. Le renard qui vivait là dont nous avons conservé les empreintes dans le terrazzo, avant de le libérer dans la forêt. Au moment du référendum lorsqu’il a fallu, convaincre, chercher des « petits sous », beaucoup, avec une simple maquette. Ce plaisir du récit a été communicatif.
Je dois aussi dire qu’il y a eu un alignement de planètes avec l’architecte François Jolliet et son cabinet Pont 12. Ils ont tout simplement conçu le projet idéal. Ensemble, nous sommes allés visiter plein de théâtres pour noter les points forts et les manques. Nous avons ramené ici tout ce que nous avons adoré ailleurs et éviter ce que nous avons détesté. Le projet a été pensé en fonction de nos connaissances, de notre intuition et surtout de nos expériences cumulées.
Au final, une alchimie est née entre la Ville de Carouge, le cabinet Pont 12 et l’équipe du théâtre. Tout le monde avait envie de réussir. On ne construit pas quinze théâtres dans une vie, donc il doit être réussi !
Et puis, il y a quelque chose qui m’échappe, de l’ordre de l’inexplicable mais que j’ai senti dès le début des travaux. Peut-être le fait de reconstruire là où se trouvait l’ancienne salle François Simon, là où il y avait déjà eu du théâtre, a dû réveiller des fantômes bienveillants. Et participer à apporter ce petit supplément d’âme, rare et précieux, qu’il faut continuer d’entretenir avec ferveur.
* La Cuisine : en 2018, débute la reconstruction du Théâtre de Carouge. Durant les travaux, la programmation se joue à La Cuisine, théâtre éphémère situé rue Baylon, à Carouge. À l’ouverture du nouveau Théâtre de Carouge en janvier 2022, La Cuisine sera vendue, déplacée et reconstruite, pour devenir la grande salle du Théâtre National de Nice.
A lire aussi

Igaëlle Venegas, auto-métamorphoses…
“J’aime l’idée de découvrir quelque chose qui est déjà là, en moi, et de lui permettre de se manifester librement en jouant.”
Entretien signé Stella LO PINTO

Tatiana Baumgartner à vif et sans fard
“J’ai découvert que j’aimais écrire du théâtre. Les dialogues, les interactions, double sens et sens cachés dans ce que les gens disent. La manipulation derrière le langage.”
Entretien signé Delphine Horst
![Entretien avec Toni Teixeira, créateur costumes – L’Empire des signes [Acte 4]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/12/01-Toni-Teixeira@Michael-Gabriel-1.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Toni Teixeira, créateur costumes – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig

Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (II)
Entretien signé Laure Hirsig

Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (I)
Entretien signé Laure Hirsig

Pierre Monnard, le cinéma et ses multiples ingrédients
Propos recueillis par Sami Kali
![Dorothée Thébert, photographe de plateau – L’Empire des signes [Acte 4]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/09/01-Dorothee-Thebert©Nora-Teylouni-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Dorothée Thébert, photographe de plateau – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig

« 200 francs, ça suffit ! » : Danger pour la RTS, la culture et la fiction
Propos recueillis par François Marin

Cyprien Colombo La vie n’est pas un long flow* tranquille
Article signé Laure Hirsig

Wave Bonardi et Julia Portier : Vertige de l’humour
Entretien signé Marie Lou Félix

Davide Brancato, king of the glam – Ubiquité (acte VII)
Entretien signé Laure Hirsig

Dominique Bourquin, les angles pas droits
Propos recueillis par Delphine Horst

Leon Salazar, le charme de l’ambivalence – Ubiquité (acte VI)
Entretien signé Laure Hirsig

Yvette Théraulaz : un peu, beaucoup ; à l’infini
Propos recueillis par Marie Lou Félix
![Entretien avec Danielle Milovic – L’Empire des signes [Acte 3]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/04/03-Tania-De-Paola-dans-_Le-jardin-de-la-grosse-dame_©Danielle-Milovic.jpg?resize=1000%2C666&ssl=1)
Entretien avec Danielle Milovic – L’Empire des signes [Acte 3]
Entretien signé Laure Hirsig

Arcadi Radeff, la quête instinctive
Propos recueillis par Sami Kali

Maurice Aufair, acteur découvreur
Propos recueillis par Marie-Lou Félix
![Entretien avec Amélie CHÉRUBIN – Ubiquité [Acte 5]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/03/07-_La-Methode-Gronholm_-Cie-Magnifique-Theatre©Guillaume-Perret.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Amélie CHÉRUBIN – Ubiquité [Acte 5]
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec Pierre Audétat – L’Empire des signes [Acte 2]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/02/Pierre-Audeta-2013t©Sebastien-Kohler-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Pierre Audétat – L’Empire des signes [Acte 2]
Entretien signé Laure Hirsig

DIANE ALBASINI : Une Artiste aux Mille Facettes
Entretien signé Anne Thorens

Entretien avec Charlotte Chabbey, l’esprit collectif
Propos recueillis par Sami Kali

Entretien avec CAMILLE MERMET, son pluriel des familles
Propos recueillis par Delphine Horst
![Entretien avec avec Déborah Helle – L’Empire des signes [Acte 1]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2024/01/Deborah-Helle©Neige-Sanchez-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec avec Déborah Helle – L’Empire des signes [Acte 1]
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec avec Stéphane Rentznik- Ubiquité [Acte IV]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/12/Derrière-les-maux_©PhilippePache.-jpg-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec avec Stéphane Rentznik- Ubiquité [Acte IV]
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec Anna PIERI ZUERCHER – Ubiquité [Acte III]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/12/tournage-série-_Tatort_©Sava-Hlavacek-1.jpg?resize=1000%2C667&ssl=1)
Entretien avec Anna PIERI ZUERCHER – Ubiquité [Acte III]
Entretien signé Laure Hirsig

Djemi Pittet Sané: Respirer à la Racine
Propos recueillis par Marie Lou Félix
![Entretien avec Nastassja Tanner – Ubiquité [Acte II]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/10/01-photo-tirée-du-film-_Dévoilées_-de-Jacob-Berger©DR.png?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Nastassja Tanner – Ubiquité [Acte II]
Entretien signé Laure Hirsig

Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.

Nicole Borgeat, serial thrilleuse
Portrait de la réalisatrice signé Laure Hirsig,

Entretien avec Marie Ripoll
Entretien signé Laure Hirsig
![Entretien avec Wissam Arbache ¦ Ubiquité [Acte I]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/08/photo-de-lopéra-_Robert-Le-Diable_©Viktor-Viktorov-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Entretien avec Wissam Arbache ¦ Ubiquité [Acte I]
Entretien signé Laure Hirsig
![Claire Darnalet et Yvan Rihs | Le génie des ingénu.e.s [Acte IV]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2023/01/projet-Astroland©AlinePaley-scaled.jpg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Claire Darnalet et Yvan Rihs | Le génie des ingénu.e.s [Acte IV]
Pour clore le feuilleton Le Génie des ingénu.e.s (IV), la parole passionnée de Claire Darnalet, 21 ans, élève en 1ère année à La Manufacture* […]
![Valeria Bertolotto et Tobia Giorla ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte III]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2022/12/Tobia-Giorla©Dennis-Mader-scaled.jpeg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Valeria Bertolotto et Tobia Giorla ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte III]
Entretiens signés Laure Hirsig

Safi Martin-Yé bouillonne de cultureS
Portrait de la comédienne signé Laure Hirsig,
![Lokman Debabeche et Nathalie Lannuzel ¦ Le génie des ingénu.e.s” [acte II]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2022/09/©Lokman-Debabeche.jpeg?resize=1080%2C675&ssl=1)
Lokman Debabeche et Nathalie Lannuzel ¦ Le génie des ingénu.e.s” [acte II]
Suite du feuilleton avec Lokman Debabeche. À 23 ans, il démarre sa 3ème année à l’école des Teintureries de Lausanne, enrichi par un parcours personnel qui associe turbulence et sagesse […]

Laurence Perez: Scène suisse, un pont pour danser en Avignon
L’an prochain, Laurence Perez cédera les rênes de « Sélection suisse en Avignon » à Esther Welger-Barboza. En attendant, l’actuelle directrice artistique et exécutive couve une ultime volée dont elle défend avec détermination la singularité.
![Liv Van Thuyne et Serge Martin ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte I]](https://i0.wp.com/blog.comedien.ch/wp-content/uploads/2022/07/Serge-Martin-photo-du-spectacle-Copies©Olivier-Carrel-2.jpeg?resize=640%2C427&ssl=1)
Liv Van Thuyne et Serge Martin ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte I]
Pour inaugurer ce feuilleton, je m’entretiens avec Liv Van Thuyne, 22 ans, élève de 1ère année à l’école Serge Martin. Malgré son jeune âge, elle s’est déjà frottée au large spectre des arts, sensible aux subtilités qu’offre chacun d’eux. En écho, la magie de la pensée concentrée du maître Serge Martin, qui dit tant en si peu de mots.

Le théâtre-zèbre de Marielle Pinsard
Marielle Pinsard m’a offert mon premier plongeon théâtral. Alors que l’année 2001 allait s’éteindre, Marielle mettait le feu aux poudres avec Comme des couteaux, pièce dont elle était à la fois l’auteure et la metteure en scène.

Michel Vinaver, homme de l’être
Dramaturge et écrivain, mais aussi ancien chef d’entreprise, Michel Vinaver s’est éteint ce 1er mai à 95 ans. En hommage, les extraits d’un entretien accordé il y a quelques années.

Bienvenue dans la 4e dimension de Lucas Savioz! – Rétrofuturiste (VI)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce sixième volet, on traverse l’écran en compagnie de Lucas Savioz.

Faim de séries? La RTS mijote petits et grands plats…
Pandémie ou pas, la loi des séries continue de s’imposer en Suisse comme ailleurs. Entre audaces calculées et contraintes diverses, la RTS trace sa voie dans un univers qui est aussi synonyme d’emplois.

Guillaume Prin, pour un théâtre nomade fait maison – Rétrofuturiste (V)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce cinquième épisode, on embarque à bord du camion-théâtre de Guillaume Prin.

Jean-Louis Johannides, into the wild – Rétrofuturiste (IV)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce 4e volet, on part à la conquête des grands espaces aux côtés de Jean-Louis Johannides.

Alain Borek fait jeu de tout bois – Rétrofuturiste (III)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Ce troisième volet donne la parole au comédien Alain Borek.

Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.

Lucie Zelger ou l’art du contrepoint – Rétrofuturiste (I)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Un voyage des racines jusqu’à l’horizon qu’inaugure la comédienne Lucie Zelger.

Mali Van Valenberg se mêle au vent
Série “J’ai deux amours” (VI). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour cet ultime volet, Laure Hirsig parle écriture avec Mali Van Valenberg.

Alexandra Marcos, voix double
Série “J’ai deux amours” (V). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce nouveau volet, Laure Hirsig suis les “voies” d’Alexandra Marcos.

Paroles de scénaristes : où en est la Suisse?
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.

La Manufacture: la conquête de l’espace
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.

Sébastien Ribaux, l’amour de la psyché
Série “J’ai deux amours” (IV). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile le “double je” de Sébastien Ribaux.

Delphine Lanza, au Pays des merveilles
Série “J’ai deux amours” (III). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile les “multiples palettes” de Delphine Lanza.

Noémie Griess, au plateau et au micro
Série “J’ai deux amours” (II). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce deuxième volet, Laure Hirsig échange avec Noémie Griess sur ce “double jeu”.

Garance La Fata, l’esprit boomerang
Série “J’ai deux amours” (I). Parce que la vie ne s’arrête pas à la scène, certain.e.s comédien.ne.s s’emploient à jouer un rôle bien ancré dans le réel. Pour ce volet inaugural, Laure Hirsig échange avec Garance La Fata sur ce “double jeu”.

Joël Hefti, portrait extérieur
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce sixième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Joël Hefti.

Roberto Garieri, de chair et de mots
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce cinquième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Garieri.

Le parler swing de Roberto Molo
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce quatrième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Molo.

Djamel Bel Ghazi, tempête sous un crâne
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce troisième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Djamel Bel Ghazi.

Aux Teintureries, Nathalie Lannuzel fait “bouger les lignes”
Ouverte en 1997 sous l’impulsion de François Landolt, l’école supérieure de théâtre Les Teintureries à Lausanne cultive l’altérité et valorise l’audace. Rencontre avec sa directrice artistique, Nathalie Lannuzel.

Xavier Loira, dandy cash
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce deuxième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Xavier Loira.

Boubacar Samb, sentinelle sans tabou
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce premier volet d’une série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien d’origine sénégalaise, Boubacar Samp.

Carlo Brandt, l’homme renversé (II)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Second et dernier chapitre d’un entretien sans fard.

Carlo Brandt, l’homme renversé (I)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Premier chapitre.

Julia Perazzini chatouille l’invisible – Fatal(e)s VI
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce dernier volet, elle se laisse entraîner par la comédienne Julia Perazzini dans les limbes de l’enfance.

Isabelle Caillat au coeur de la crise
La comédienne genevoise s’impose en femme de tête et de coeur dans « Cellule de crise », nouvelle série signée Jacob Berger qui nous dévoile les arcanes de l’humanitaire. Entretien à la veille de la diffusion.

Prune Beuchat, comme un ouragan – Fatal(e)s V
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce 5e volet, on croque dans une Prune qui ne compte pas pour des prunes!

Olivier Lafrance, entretien avec un vampire – Fatal(e)s IV
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Le comédien Olivier Lafrance se prête à ce jeu d’ombre.

“Je suis pour les quotas d’auteur.e.s suisses”
A la suite de notre enquête sur le statut de l’auteur.e en Suisse romande, le dramaturge et metteur en scène Julien Mages défend l’idée d’une écriture typiquement “suisse”.

Pour Camille Giacobino, le ciel peut attendre – Fatal(e)s III
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Amour et mort, deux thèmes que fréquente régulièrement Camille Giacobino, comme comédienne ou comme metteuse-en-scène.

Y’a-t-il encore un.e auteur.e dans la salle?
Acteur.trice à la fois central et à part, l’auteur.e d’un spectacle ou d’un film doit composer avec des contraintes qui laissent peu de place à l’ego. Trois d’entre eux/elles nous parlent de leur pratique.

Cédric Leproust, le Garçon et la Mort – Fatal(e)s II
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Au comédien Cédric Leproust de nous entraîner dans le territoire des ombres.

Julia Batinova, l’art de la fougue – Fatal(e)s
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig inaugure une nouvelle série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Première à s’y coller, la comédienne Julia Batinova.

Alain Mudry, colosse au clair de lune
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce sixième “Traversée en solitaire”, on se met sur orbite avec Alain Mudry.

Serge Valletti brise le glas à Avignon
Acteur, auteur, scénariste aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, Serge Valletti a mis du baume aristophanesque sur les plaies du festival avorté. Rencontre.

Arblinda Dauti, la perle noire
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce cinquième “Traversée en solitaire”, on se fait la belle avec Arblinda Dauti.

David Valère, l’homme debout qui met le chaos K.O.
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce quatrième “Traversée en solitaire”, on fend les flots avec David Valère.

Olivia Csiky Trnka, l’extra-terrienne
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce troisième “Traversée en solitaire”, on décolle aux côtés d’Olivia Csiky Trnka.

Raphaël Vachoux, sans peur ni reproche
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce deuxième “Traversée en solitaire”, on embarque aux côtés de Raphaël Vachoux.

Jacques Michel, l’échappée belle
En six décennies de carrière, le comédien a endossé tous les costumes. Acteur dans tous les sens du terme, il a construit une histoire qui déborde la sienne, celle du théâtre romand. Portrait.

Lola Giouse, Miss en tropisme
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude, ses charmes comme sa nocivité dans leur parcours et leur pratique. Pour cette première “Traversée en solitaire”, on largue les amarres avec Lola Giouse.

Françoise Boillat La Dame du lac – Le théâtre dans la peau (VI)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Sixième acte avec la comédienne Françoise Boillat.

Un dernier café avec Michel Piccoli
L’acteur nous a quitté le 12 mai, à l’âge de 94 ans. En guise d’hommage, des extraits inédits d’un entretien accordé à Lionel Chiuch à l’occasion de la tournée de “Minetti”, de Thomas Bernhard.

Julien TSONGAS Préda(c)teur- Le théâtre dans la peau (V)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Cinquième acte avec le comédien Julien Tsongas.

Sandro De Feo Mutant mutin mutique-Le théâtre dans la peau (IV)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Quatrième acte avec le comédien Sandro De Feo.

“Il reste dans la culture une sorte de mépris de classe”
Après un septennat à la tête du GIFF, Emmanuel Cuénod s’apprête à en remettre les clés. Dans un long entretien sans langue de bois, il nous parle du festival genevois et donne quelques coups de griffe à la politique culturelle suisse.

François Revaclier Le spirituel danse l’art – Le théâtre dans la peau (III)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Troisième acte avec le comédien François Revaclier.

Valérie Liengme La créature – Le théâtre dans la peau (II)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Deuxième acte avec la comédienne Valérie Liengme.

Joëlle Fontannaz La magnétique au magnéto – Le théâtre dans la peau (I)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Premier acte avec la comédienne Joëlle Fontannaz.

Monica Budde, la voix libre
D’Andromaque de Racine au personnage de A de Sarah Kane, la comédienne Monica Budde campe des femmes qui, comme elle, ne s’en laissent pas conter. Portrait en toute liberté.

Braqueur de banques!
Alors que la saison 2 de « Quartier des banques » débarque sur les écrans, son réalisateur, Fulvio Bernasconi, nous parle de son rapport aux comédien(ne)s.

“Molière écrit pour sauver les meubles”
Aussi à l’aise chez Molière que chez Ionesco, Michel Bouquet, 94 ans, a voué sa vie aux auteurs. Il les évoque ici.

“L’avantage ici, c’est le Système D”
A la Chaux-de-Fonds, pays des merveilles mécaniques, on croise moins de lapin blanc que de drapeau noir. La comédienne Aurore Faivre brandit celui d’un théâtre qui ose et qui place l’humain au centre.

“Il faut rester punk dans l’âme” – Cherchez l’enfant avec Fréderic Polier
Acteur, metteur en scène, raconteur d’histoires et tricoteur de fictions, Frédéric Polier continue de croiser le fer pour un théâtre généreux et rebelle.

Daniel Vouillamoz: “Nous vivons l’époque du théâtre selfie”
Avec l’amour, la haine n’est jamais très loin. Acteur, auteur, metteur en scène mais aussi musicien, Daniel Vouillamoz effeuille volontiers la marguerite quand il parle de théâtre, cet « art pathétiquement inutile et pourtant essentiel ».

Gilles Tschudi: “C’est vrai, je ne connais pas de barrière”
Acteur puissant et subtil, Gilles Tschudi n’hésite pas à se mettre à nu, comme dans « Souterrainblues », mis en scène par Maya Bösch il y a près de dix ans au Grütli. Mais l’homme dévoile volontiers aussi ce qui « l’agit » et dresse ici une véritable métaphysique du jeu.

Jean-Luc Borgeat: “Le personnage, je ne sais pas ce que c’est”
Acteur, metteur en scène, écrivain, Jean-Luc Borgeat ne boude la parole que lorsqu’il se pose au bord d’un cours d’eau pour pêcher à la mouche.

Théâtre des Osses, théâtre de chair
On prend les chemins de traverse jusqu’à Givisiez pour y rencontrer Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. Leur nouvelle saison regarde la planète en face.

Sarah Marcuse: Tribulations avignonnaises
En 2018, la comédienne et metteure en scène genevoise Sarah Marcuse s’est frottée au Festival Off. Elle en rapporte un témoignage fort que nous reproduisons ici avec son aimable autorisation.

Carole Epiney, névrosée à temps partiel
Elle était impeccable dans « Les névroses sexuelles de nos parents ». La valaisanne Carole Epiney affronte les aléas de la vie de comédienne romande avec une belle énergie.

On ne peut pas être aimé par tout le monde
Difficile, l’exercice du casting? Pour comedien.ch, Nathalie Chéron, trente ans à chercher la perle rare, livre quelques « trucs » pour faire baisser la pression.
Toutes les rencontres
Adrien Barazzone, les frissons d’un Premier de cordée
« Selon moi, jouer c’est trouver la bonne distance, avec son propos, son personnage et le public. »
Entretien signé Laure Hirsig
Sabine Timoteo, danser vers le dedans
“A l’origine, danser, c’était la joie de me sentir vivante.”
Entretien signé Delphine Horst
Valerio Scamuffa : une poétique de l’échappée
“S’il y a un art fantomatique, c’est peut-être bien le théâtre. ”
Entretien signé Marie Lou Félix
Nicolas Müller – L’Art du décalage
« Je me rappelle de ces sensations de liberté et de soulagement durant les premiers spectacles. Cet espace qui s’ouvrait, s’éveillait, demeure la raison pour laquelle je pratique le théâtre aujourd’hui. »
Entretien signé Solange Schifferdecker
Igaëlle Venegas, auto-métamorphoses…
“J’aime l’idée de découvrir quelque chose qui est déjà là, en moi, et de lui permettre de se manifester librement en jouant.”
Entretien signé Stella LO PINTO
Tatiana Baumgartner à vif et sans fard
“J’ai découvert que j’aimais écrire du théâtre. Les dialogues, les interactions, double sens et sens cachés dans ce que les gens disent. La manipulation derrière le langage.”
Entretien signé Delphine Horst
Entretien avec Toni Teixeira, créateur costumes – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig
Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (II)
Entretien signé Laure Hirsig
Véronique Mermoud, sa majesté des Osses (I)
Entretien signé Laure Hirsig
Pierre Monnard, le cinéma et ses multiples ingrédients
Propos recueillis par Sami Kali
Dorothée Thébert, photographe de plateau – L’Empire des signes [Acte 4]
Entretien signé Laure Hirsig
« 200 francs, ça suffit ! » : Danger pour la RTS, la culture et la fiction
Propos recueillis par François Marin
Cyprien Colombo La vie n’est pas un long flow* tranquille
Article signé Laure Hirsig
Wave Bonardi et Julia Portier : Vertige de l’humour
Entretien signé Marie Lou Félix
Davide Brancato, king of the glam – Ubiquité (acte VII)
Entretien signé Laure Hirsig
Dominique Bourquin, les angles pas droits
Propos recueillis par Delphine Horst
Leon Salazar, le charme de l’ambivalence – Ubiquité (acte VI)
Entretien signé Laure Hirsig
Yvette Théraulaz : un peu, beaucoup ; à l’infini
Propos recueillis par Marie Lou Félix
Entretien avec Danielle Milovic – L’Empire des signes [Acte 3]
Entretien signé Laure Hirsig
Arcadi Radeff, la quête instinctive
Propos recueillis par Sami Kali
Maurice Aufair, acteur découvreur
Propos recueillis par Marie-Lou Félix
Entretien avec Amélie CHÉRUBIN – Ubiquité [Acte 5]
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec Pierre Audétat – L’Empire des signes [Acte 2]
Entretien signé Laure Hirsig
DIANE ALBASINI : Une Artiste aux Mille Facettes
Entretien signé Anne Thorens
Entretien avec Charlotte Chabbey, l’esprit collectif
Propos recueillis par Sami Kali
Entretien avec CAMILLE MERMET, son pluriel des familles
Propos recueillis par Delphine Horst
Entretien avec avec Déborah Helle – L’Empire des signes [Acte 1]
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec avec Stéphane Rentznik- Ubiquité [Acte IV]
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec Anna PIERI ZUERCHER – Ubiquité [Acte III]
Entretien signé Laure Hirsig
Djemi Pittet Sané: Respirer à la Racine
Propos recueillis par Marie Lou Félix
Entretien avec Nastassja Tanner – Ubiquité [Acte II]
Entretien signé Laure Hirsig
Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.
Nicole Borgeat, serial thrilleuse
Portrait de la réalisatrice signé Laure Hirsig,
Entretien avec Marie Ripoll
Entretien signé Laure Hirsig
Entretien avec Wissam Arbache ¦ Ubiquité [Acte I]
Entretien signé Laure Hirsig
Claire Darnalet et Yvan Rihs | Le génie des ingénu.e.s [Acte IV]
Pour clore le feuilleton Le Génie des ingénu.e.s (IV), la parole passionnée de Claire Darnalet, 21 ans, élève en 1ère année à La Manufacture* […]
Valeria Bertolotto et Tobia Giorla ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte III]
Entretiens signés Laure Hirsig
Safi Martin-Yé bouillonne de cultureS
Portrait de la comédienne signé Laure Hirsig,
Lokman Debabeche et Nathalie Lannuzel ¦ Le génie des ingénu.e.s” [acte II]
Suite du feuilleton avec Lokman Debabeche. À 23 ans, il démarre sa 3ème année à l’école des Teintureries de Lausanne, enrichi par un parcours personnel qui associe turbulence et sagesse […]
Laurence Perez: Scène suisse, un pont pour danser en Avignon
L’an prochain, Laurence Perez cédera les rênes de « Sélection suisse en Avignon » à Esther Welger-Barboza. En attendant, l’actuelle directrice artistique et exécutive couve une ultime volée dont elle défend avec détermination la singularité.
Liv Van Thuyne et Serge Martin ¦ Le génie des ingénu.e.s [acte I]
Pour inaugurer ce feuilleton, je m’entretiens avec Liv Van Thuyne, 22 ans, élève de 1ère année à l’école Serge Martin. Malgré son jeune âge, elle s’est déjà frottée au large spectre des arts, sensible aux subtilités qu’offre chacun d’eux. En écho, la magie de la pensée concentrée du maître Serge Martin, qui dit tant en si peu de mots.
Le théâtre-zèbre de Marielle Pinsard
Marielle Pinsard m’a offert mon premier plongeon théâtral. Alors que l’année 2001 allait s’éteindre, Marielle mettait le feu aux poudres avec Comme des couteaux, pièce dont elle était à la fois l’auteure et la metteure en scène.
Michel Vinaver, homme de l’être
Dramaturge et écrivain, mais aussi ancien chef d’entreprise, Michel Vinaver s’est éteint ce 1er mai à 95 ans. En hommage, les extraits d’un entretien accordé il y a quelques années.
Bienvenue dans la 4e dimension de Lucas Savioz! – Rétrofuturiste (VI)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce sixième volet, on traverse l’écran en compagnie de Lucas Savioz.
Faim de séries? La RTS mijote petits et grands plats…
Pandémie ou pas, la loi des séries continue de s’imposer en Suisse comme ailleurs. Entre audaces calculées et contraintes diverses, la RTS trace sa voie dans un univers qui est aussi synonyme d’emplois.
Guillaume Prin, pour un théâtre nomade fait maison – Rétrofuturiste (V)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce cinquième épisode, on embarque à bord du camion-théâtre de Guillaume Prin.
Jean-Louis Johannides, into the wild – Rétrofuturiste (IV)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Pour ce 4e volet, on part à la conquête des grands espaces aux côtés de Jean-Louis Johannides.
Alain Borek fait jeu de tout bois – Rétrofuturiste (III)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Ce troisième volet donne la parole au comédien Alain Borek.
Isabelle Vesseron, l’utopie à tout prix – Rétrofuturiste (II)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Deuxième épisode avec la comédienne Isabelle Vesseron.
Lucie Zelger ou l’art du contrepoint – Rétrofuturiste (I)
Signée Laure Hirsig, la série “Rétrofuturiste” questionne les comédien.ne.s sur leur passé et les invite à scruter l’avenir. Un voyage des racines jusqu’à l’horizon qu’inaugure la comédienne Lucie Zelger.
Mali Van Valenberg se mêle au vent
Série “J’ai deux amours” (VI). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour cet ultime volet, Laure Hirsig parle écriture avec Mali Van Valenberg.
Alexandra Marcos, voix double
Série “J’ai deux amours” (V). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce nouveau volet, Laure Hirsig suis les “voies” d’Alexandra Marcos.
Paroles de scénaristes : où en est la Suisse?
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.
La Manufacture: la conquête de l’espace
Depuis sa création en 2003, la Haute école des arts de la scène, implantée à Lausanne, n’a cessé de déployer le champ de ses recherches artistiques tout en multipliant ses filières. Au point qu’elle se sent désormais un peu à l’étroit entre les murs de l’ancienne usine de taille de pierres précieuses.
Sébastien Ribaux, l’amour de la psyché
Série “J’ai deux amours” (IV). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile le “double je” de Sébastien Ribaux.
Delphine Lanza, au Pays des merveilles
Série “J’ai deux amours” (III). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Laure Hirsig dévoile les “multiples palettes” de Delphine Lanza.
Noémie Griess, au plateau et au micro
Série “J’ai deux amours” (II). Parce qu’il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans son jeu, certain.e.s comédien.ne.s partagent leur temps entre plusieurs activités. Pour ce deuxième volet, Laure Hirsig échange avec Noémie Griess sur ce “double jeu”.
Garance La Fata, l’esprit boomerang
Série “J’ai deux amours” (I). Parce que la vie ne s’arrête pas à la scène, certain.e.s comédien.ne.s s’emploient à jouer un rôle bien ancré dans le réel. Pour ce volet inaugural, Laure Hirsig échange avec Garance La Fata sur ce “double jeu”.
Joël Hefti, portrait extérieur
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce sixième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Joël Hefti.
Roberto Garieri, de chair et de mots
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce cinquième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Garieri.
Le parler swing de Roberto Molo
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce quatrième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Roberto Molo.
Djamel Bel Ghazi, tempête sous un crâne
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce troisième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Djamel Bel Ghazi.
Aux Teintureries, Nathalie Lannuzel fait “bouger les lignes”
Ouverte en 1997 sous l’impulsion de François Landolt, l’école supérieure de théâtre Les Teintureries à Lausanne cultive l’altérité et valorise l’audace. Rencontre avec sa directrice artistique, Nathalie Lannuzel.
Xavier Loira, dandy cash
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce deuxième volet de la série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien Xavier Loira.
Boubacar Samb, sentinelle sans tabou
Quand on est comédien.ne, un particularisme ethnique, morphologique, biographique ou culturel représente-t-il un atout? Dans ce premier volet d’une série intitulée “Mon truc à moi”, Laure Hirsig pose la question au comédien d’origine sénégalaise, Boubacar Samp.
Carlo Brandt, l’homme renversé (II)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Second et dernier chapitre d’un entretien sans fard.
Carlo Brandt, l’homme renversé (I)
Pour nous, Carlo Brandt a prêté ses traits au visage inquiet et brut du monde. Comédien d’exception, il se livre dans un portrait intime dressé par Laure Hirsig. Premier chapitre.
Julia Perazzini chatouille l’invisible – Fatal(e)s VI
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce dernier volet, elle se laisse entraîner par la comédienne Julia Perazzini dans les limbes de l’enfance.
Isabelle Caillat au coeur de la crise
La comédienne genevoise s’impose en femme de tête et de coeur dans « Cellule de crise », nouvelle série signée Jacob Berger qui nous dévoile les arcanes de l’humanitaire. Entretien à la veille de la diffusion.
Prune Beuchat, comme un ouragan – Fatal(e)s V
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Pour ce 5e volet, on croque dans une Prune qui ne compte pas pour des prunes!
Olivier Lafrance, entretien avec un vampire – Fatal(e)s IV
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Le comédien Olivier Lafrance se prête à ce jeu d’ombre.
“Je suis pour les quotas d’auteur.e.s suisses”
A la suite de notre enquête sur le statut de l’auteur.e en Suisse romande, le dramaturge et metteur en scène Julien Mages défend l’idée d’une écriture typiquement “suisse”.
Pour Camille Giacobino, le ciel peut attendre – Fatal(e)s III
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig place ses entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Amour et mort, deux thèmes que fréquente régulièrement Camille Giacobino, comme comédienne ou comme metteuse-en-scène.
Y’a-t-il encore un.e auteur.e dans la salle?
Acteur.trice à la fois central et à part, l’auteur.e d’un spectacle ou d’un film doit composer avec des contraintes qui laissent peu de place à l’ego. Trois d’entre eux/elles nous parlent de leur pratique.
Cédric Leproust, le Garçon et la Mort – Fatal(e)s II
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig poursuit sa série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Au comédien Cédric Leproust de nous entraîner dans le territoire des ombres.
Julia Batinova, l’art de la fougue – Fatal(e)s
Avec “Fatal(e)s”, Laure Hirsig inaugure une nouvelle série d’entretiens sous l’égide d’Eros et Thanatos. Première à s’y coller, la comédienne Julia Batinova.
Alain Mudry, colosse au clair de lune
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce sixième “Traversée en solitaire”, on se met sur orbite avec Alain Mudry.
Serge Valletti brise le glas à Avignon
Acteur, auteur, scénariste aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, Serge Valletti a mis du baume aristophanesque sur les plaies du festival avorté. Rencontre.
Arblinda Dauti, la perle noire
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce cinquième “Traversée en solitaire”, on se fait la belle avec Arblinda Dauti.
David Valère, l’homme debout qui met le chaos K.O.
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce quatrième “Traversée en solitaire”, on fend les flots avec David Valère.
Olivia Csiky Trnka, l’extra-terrienne
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce troisième “Traversée en solitaire”, on décolle aux côtés d’Olivia Csiky Trnka.
Raphaël Vachoux, sans peur ni reproche
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude dans leur parcours et leur pratique. Pour ce deuxième “Traversée en solitaire”, on embarque aux côtés de Raphaël Vachoux.
Jacques Michel, l’échappée belle
En six décennies de carrière, le comédien a endossé tous les costumes. Acteur dans tous les sens du terme, il a construit une histoire qui déborde la sienne, celle du théâtre romand. Portrait.
Lola Giouse, Miss en tropisme
La “crise de la quarantaine” a donné l’occasion à Laure Hirsig de questionner comédiennes et comédiens sur la solitude, ses charmes comme sa nocivité dans leur parcours et leur pratique. Pour cette première “Traversée en solitaire”, on largue les amarres avec Lola Giouse.
Françoise Boillat La Dame du lac – Le théâtre dans la peau (VI)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Sixième acte avec la comédienne Françoise Boillat.
Un dernier café avec Michel Piccoli
L’acteur nous a quitté le 12 mai, à l’âge de 94 ans. En guise d’hommage, des extraits inédits d’un entretien accordé à Lionel Chiuch à l’occasion de la tournée de “Minetti”, de Thomas Bernhard.
Julien TSONGAS Préda(c)teur- Le théâtre dans la peau (V)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Cinquième acte avec le comédien Julien Tsongas.
Sandro De Feo Mutant mutin mutique-Le théâtre dans la peau (IV)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Quatrième acte avec le comédien Sandro De Feo.
“Il reste dans la culture une sorte de mépris de classe”
Après un septennat à la tête du GIFF, Emmanuel Cuénod s’apprête à en remettre les clés. Dans un long entretien sans langue de bois, il nous parle du festival genevois et donne quelques coups de griffe à la politique culturelle suisse.
François Revaclier Le spirituel danse l’art – Le théâtre dans la peau (III)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Troisième acte avec le comédien François Revaclier.
Valérie Liengme La créature – Le théâtre dans la peau (II)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Deuxième acte avec la comédienne Valérie Liengme.
Joëlle Fontannaz La magnétique au magnéto – Le théâtre dans la peau (I)
Signé Laure Hirsig, (IN)CARNATIONS est un feuilleton qui donne la parole autrement à celles et ceux dont la voix publique s’est tue un vendredi 13. Premier acte avec la comédienne Joëlle Fontannaz.
Monica Budde, la voix libre
D’Andromaque de Racine au personnage de A de Sarah Kane, la comédienne Monica Budde campe des femmes qui, comme elle, ne s’en laissent pas conter. Portrait en toute liberté.
Braqueur de banques!
Alors que la saison 2 de « Quartier des banques » débarque sur les écrans, son réalisateur, Fulvio Bernasconi, nous parle de son rapport aux comédien(ne)s.
“Molière écrit pour sauver les meubles”
Aussi à l’aise chez Molière que chez Ionesco, Michel Bouquet, 94 ans, a voué sa vie aux auteurs. Il les évoque ici.
“L’avantage ici, c’est le Système D”
A la Chaux-de-Fonds, pays des merveilles mécaniques, on croise moins de lapin blanc que de drapeau noir. La comédienne Aurore Faivre brandit celui d’un théâtre qui ose et qui place l’humain au centre.
“Il faut rester punk dans l’âme” – Cherchez l’enfant avec Fréderic Polier
Acteur, metteur en scène, raconteur d’histoires et tricoteur de fictions, Frédéric Polier continue de croiser le fer pour un théâtre généreux et rebelle.
Daniel Vouillamoz: “Nous vivons l’époque du théâtre selfie”
Avec l’amour, la haine n’est jamais très loin. Acteur, auteur, metteur en scène mais aussi musicien, Daniel Vouillamoz effeuille volontiers la marguerite quand il parle de théâtre, cet « art pathétiquement inutile et pourtant essentiel ».
Gilles Tschudi: “C’est vrai, je ne connais pas de barrière”
Acteur puissant et subtil, Gilles Tschudi n’hésite pas à se mettre à nu, comme dans « Souterrainblues », mis en scène par Maya Bösch il y a près de dix ans au Grütli. Mais l’homme dévoile volontiers aussi ce qui « l’agit » et dresse ici une véritable métaphysique du jeu.
Jean-Luc Borgeat: “Le personnage, je ne sais pas ce que c’est”
Acteur, metteur en scène, écrivain, Jean-Luc Borgeat ne boude la parole que lorsqu’il se pose au bord d’un cours d’eau pour pêcher à la mouche.
Théâtre des Osses, théâtre de chair
On prend les chemins de traverse jusqu’à Givisiez pour y rencontrer Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. Leur nouvelle saison regarde la planète en face.
Sarah Marcuse: Tribulations avignonnaises
En 2018, la comédienne et metteure en scène genevoise Sarah Marcuse s’est frottée au Festival Off. Elle en rapporte un témoignage fort que nous reproduisons ici avec son aimable autorisation.
Carole Epiney, névrosée à temps partiel
Elle était impeccable dans « Les névroses sexuelles de nos parents ». La valaisanne Carole Epiney affronte les aléas de la vie de comédienne romande avec une belle énergie.
On ne peut pas être aimé par tout le monde
Difficile, l’exercice du casting? Pour comedien.ch, Nathalie Chéron, trente ans à chercher la perle rare, livre quelques « trucs » pour faire baisser la pression.
Il y a plus de compagnies que de films
Critique à la Tribune de Genève, Pascal Gavillet est un habitué du cinéma suisse, dont il connait bien les mécanismes. On fait le point avec lui.
Serge Martin cultive l’esprit d’équipe
Pour celui qui a créé sa propre école à Genève il y a maintenant plus de 30 ans, le théâtre reste une histoire de partage.