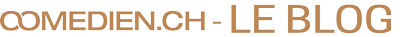Réalisatrices: franchir le miroir d’Alice
La première réalisatrice de fiction de l’histoire du cinéma, Alice Guy (1873-1968), s’est heurtée au patriarcat puis à la mémoire sélective des historiens. Si la situation s’est améliorée pour celles qui empoignent la caméra, il reste encore du chemin à accomplir.

Alice Guy, pionnière du cinéma © Torimcju Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa
Elle faisait tout, Alice Guy : secrétaire, scénariste, réalisatrice, productrice, décoratrice, costumière (voir ci-dessous)… Elle faisait tout, mais ce n’était sans doute pas assez pour les historiens, qui l’ignorèrent à l’heure d’écrire l’histoire du 7e Art. Pourtant, avec La Fée aux choux (1896), la toute jeune française – elle a alors 23 ans et travaille comme secrétaire pour la Gaumont – signe le premier film de fiction réalisé par une femme. Certains affirment même qu’il s’agit du premier film de fiction tout court, si l’on considère que L’Arroseur arrosé (1895) de Louis Lumière relève plutôt du gag filmé…
La suite de l’histoire, on la connaît : une industrie qui, si elle n’hésite pas à déshabiller les femmes à l’écran, ne leur tend la caméra qu’avec réticence. Un exemple parlant? Dans l’édition 2006 des 1001 films à voir avant de mourir figurent très précisément 23 réalisatrices sur 552 références, soit 1/24e. Comme si les femmes ne représentaient qu’une heure dans une histoire du cinéma qui durerait toute une journée ! Avec Lois Weber, Lyndall Hobbs ou encore Robin Swicord, les femmes furent pourtant à l’origine d’Hollywood. Plus présentes que les hommes, elles étaient aussi mieux payées. Cela dura une petite vingtaine d’années avant que leurs collègues masculins ne récupèrent les manettes, dont celles de la gloire.
Alors que la cinéaste Pamela B. Green s’apprête à rendre hommage à Alice Guy à travers un documentaire, et que Jean-Jacques Annaud planche sur le sujet, on assiste enfin, en Suisse comme ailleurs, à une revalorisation du rôle de la femme dans le 7e Art. Avec, pour corollaire, de plus amples soutiens et une meilleure visibilité dans la création actuelle. Ainsi, les 56e journées de Soleure, qui se sont déroulées en janvier dernier, ont consacré trois réalisatrices sur les plus hautes marches du podium : Andrea Staka, Gitta Gsell et Stefanie Klemm. Cette 56e édition accordait également une large place aux pionnières du cinéma suisse. Mais ce “réajustement” est très récent. En 2019, sur 600 films envoyés aux organisateurs.trices, seuls 30 % avaient été réalisés par des femmes. La festival s’était alors engagé en signant la charte du « Réseau audiovisuel des femmes suisses (Swiss Women’s Audiovisual Network, SWAN) », qui s’est fixé pour objectif la diversité et l’égalité de genre dans l’industrie audiovisuelle suisse. En tout début d’année, cette même association a créé le premier annuaire en ligne permettant de répertorier et de rendre visibles les femmes travaillant dans l’industrie du cinéma en Suisse. « On a beau dire que les femmes existent dans le cinéma, elles ne sont pas recommandés », déclarait alors Stéphane Mitchell, l’une des initiatrices de l’annuaire.
Moins d’argent pour les femmes
Dans un rapport consacré à « La place des femmes dans la cinématographie romande 2012-2014 », la Fondation romande pour le cinéma relève que « les réalisatrices sont représentées essentiellement dans les films de la relève (premier et deuxième long-métrage) et presque absentes (15%) de la catégorie des longs-métrages de réalisateurs expérimentés ». En clair : on laisse les réalisatrices faire un ou deux essais puis on leur ferme les portes au nez, en les aiguillant éventuellement vers la voie du documentaire. « Lorsqu’on regarde les premiers longs métrages, on ne trouve que peu de réalisatrices, constate de son côté la réalisatrice franco-suisse Ursula Meier. Puis il y en a encore moins pour les deuxièmes ; et pour les troisièmes, quatrièmes films, elles se font rares ». Le phénomène ne date pas d’hier et n’est pas une spécificité suisse. Dans un numéro de 2019 titré “Une histoire des réalisatrices”, un édito des Cahiers du cinéma donne le ton : « Parfois, beaucoup trop souvent, il n’y a pas d’oeuvre. Il y a quelques films, extrêmement prometteurs, voire un film unique, et puis une disparition ». L’éditorialiste précise toutefois que « ce qui est beau, dans cette histoire des femmes, c’est que, plus qu’une autre, elle joue des croisées entre fiction, documentaire, expérimental, long et court métrage : des formats plus libres, moins coûteux, plus autobiographique ont permis l’expression des femmes à la caméra ».
Plus de liberté, donc, mais surtout moins d’argent. « Si la part des films réalisés par des femmes est de 35 %, la part des coûts n’est que de 27 % seulement /…/ Le coût par minute est régulièrement plus bas pour les films de réalisatrices», note encore la Fondation romande dans son rapport, en cherchant l’explication « dans le plus grand nombre de films de relève » et « un déficit de financement ». Ce dernier a par ailleurs des conséquences sur la rémunération des équipes : on trouve ainsi des différences allant de 10 à 20 % pour les postes techniques. La chaîne Arte, qui a lancé en décembre dernier un concours judicieusement intitulé « Et pourtant, elles tournent », rappelle que le devis moyen des films d’initiative française réalisés par des femmes est inférieur de 40 % à celui des films réalisés par des hommes.
Si elle soutient les politiques de proportion mises en place, notamment par l’OFC, une association telle que SWAN continue de se battre pour plus de parité, plus particulièrement au niveau des postes à responsabilités – dans l’économie culturelle, 36 % des hommes exercent une fonction de direction ou de cadre, contre 24 % des femmes (étude OFC). Peu à peu, heureusement, les choses changent. De plus en plus de femmes prennent la tête de festivals, d’instances liées au cinéma, d’organismes subventionneurs. Elles changent, mais pas partout et pas à la même vitesse. Aux Etats-Unis, où dans les années 1910 Alice Guy dominait le cinéma mondial avec sa société la Solax Company, les femmes ne représentent aujourd’hui que 10% des réalisatrices – en 2019, 10,6 % des 100 premiers films du box-office américain ont été réalisés par des femmes, contre 4,5% en 2018. Si l’on veut bénéficier de toutes les sensibilités artistiques, et pas seulement de celles des hommes, il est temps désormais de passer de l’autre côté du miroir d’Alice…
Pionnière du cinéma
Elle avait du cran, Alice Guy. Et du talent. Il en fallait pour devenir pionnière d’un art qui en était alors à ses balbutiements. C’est peut-être pour cette raison, d’ailleurs, qu’on lui laissa les coudée franches. Née en 1873, dans une famille bourgeoise, c’est par hasard qu’elle se retrouve secrétaire d’un certain Léon Gaumont, ingénieur et inventeur à Paris. Par hasard, aussi, qu’elle assiste à la projection de La sortie des usines Lumières, des frères Lumière. Elle y voit une manière originale de raconter des histoires et réclame un peu de temps libre à son patron pour « écrire une ou deux saynètes et les faire jouer par des amis ». Gaumont, dont l’objectif est avant tout de vendre des caméras, accepte à condition que « son courrier n’en souffre pas ». En 1896, Alice Guy tourne La Fée au choux, une film d’une minute que l’on peut voir aujourd’hui sur Youtube.
Bientôt, la jeune femme va superviser toutes les productions Gaumont notamment les fictions qui passent de 15 % en 1900 à 80 % en 1906. Surtout, Alice Guy innove. Brassant tous les genres, du western au film de guerre en passant par les fééries, elle sort les caméras des studios, organise ses scénarios autour d’un personnage principal, invente le gros plan. En 1906, elle signe une Vie et mort du Christ de 34 minutes qui mobilise pas moins de 300 figurants. Mariée, elle s’installe ensuite aux Etats-Unis où elle va créer sa propre société : la Solax. Le succès ne tarde pas et Alice devient ainsi la femme la mieux payée des Etats-Unis. Pendant près de dix ans, elle va régner sur le cinéma mondial, formant à cette occasion l’élite des vedettes de l’époque. Ruinée à la suite de son divorce, elle rentre en France en 1922 où on l’a oubliée. Elle passera la fin de sa vie – elle meurt en 1968 à 95 ans – à tenter de récupérer ses films.