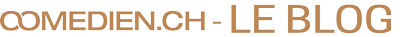Faire l’humour, pas la guerre?
Toute parole, dans un texte, sur scène, doit-elle être pesée ? Si oui, que met-on dans la balance ? L’Histoire ? L’époque ? La souffrance ? La liberté d’expression ? Tandis que la culture woke investit l’expression artistique, parfois dans l’excès, n’est-il pas temps de prendre un peu de distance pour interroger nos rires et ce qu’ils dissimulent?
Parlez-moi d’humour. Redites moi des choses drôles. Ce sera toujours mieux que l’invective, la moquerie, le jugement. Depuis peu, aborder le thème de l’humour, c’est avancer en terrain miné. La prudence est de rigueur. Récemment encore, quand la Licra Genève a voulu organiser un débat autour du thème « Humour et Antiracisme », elle s’est heurtée à un silence embarrassé. Contactés par les organisateurs, aucun des 15 comédiens, directeurs de structure, programmateur radio ou responsable de média qui programment de l’humour dans le canton de Genève n’a voulu y participer.
Si questionner l’humour devient délicat, le pratiquer revient parfois à ouvrir une boîte de Pandore. On a pu le constater en mars dernier, lorsque la comédienne Claude-Inga Barbey s’est employée à brocarder, sinon les transgenres, du moins certains aspects de leurs revendications. Aussitôt, une volée de bois vert s’est abattu sur la malheureuse. On ne se moque pas des minorités. Invitée sur le plateau d’Infrarouge, la comédienne a tenu a exprimer sa solidarité avec les personnes en souffrance mais aussi son incompréhension devant l’ampleur des réactions. Face à elle, le metteur en scène Dominique Ziegler s’est posé en avocat de la cause des groupes « minorisés ». Reprenant au vol une question du journaliste de la RTS, il a notamment affirmé que l’on pouvait rire de tout à l’exception des thèmes « racistes, sexistes, transphobes et homophobes ». Ce fut alors à son tour de subir les foudres des commentateurs, certains s’érigeant en procureur pour mieux le désigner comme tel, d’autre s’indignant qu’il puisse dresser la liste de ce dont on peut ou non rire. Cris d’orfraie contre cris d’orfraie, la suite relève de la cacophonie dont les réseaux sociaux sont malheureusement devenus familiers.
Au-delà du malentendu, réel (le parcours de Claude-Inga Barbey témoigne de son engagement en faveur de l’égalité et Dominique Ziegler n’a pas, au sens strict, « dressé » de liste), se sont cristallisés ces dernières années, dans le sillage de la « woke culture » née aux Etats-Unis, deux camps qui semblent irréconciliables. Cette opposition, qui traverse le champ de la culture en empruntant le sillon de l’humour, se caractérisent par des positions tranchées et peu soucieuses de nuances. En témoigne notamment le titre générique réducteur auquel on résume souvent la problématique : « Peut-on rire de tout? » (« Oui, mais pas pour rien », répondait Pierre Dac, pour changer de Desproges) avec son corollaire populiste : « On ne peut plus rien dire ». Deux manières de brandir haut le pavillon de la liberté d’expression qui, si elle réclame toute notre vigilance, nécessite que l’on introduise plus de complexité dans son maniement.
Faut-il, dès lors, faire l’impasse sur le sujet ? Il nous a semblé que non tant les enjeux touchent directement à la pratique de l’écriture et des métiers de la scène. D’où la volonté d’ouvrir le débat. Dans un premier temps, en tirant jusqu’à nous le fil de l’humour, au gré d’approches qui s’opposent et se complètent. Dans un deuxième temps, en demandant à Dominique Ziegler d’expliciter sa prise de position, au travers de points qui méritent précision, tel que « l’engagement de l’artiste » (entretien à découvrir en fin d’article). Plus que le sketch initial, qui n’est discutable que dans les limites d’une appréciation forcément subjective, ce sont les arguments utilisés par le metteur en scène qui peuvent constituer le socle d’un débat. Ceci, que l’on partage ou non son point de vue. Il se peut que, malgré nos précautions, l’entretien soit perçu comme un plaidoyer pro domo. Il se peut aussi, comme nous le désirons, qu’il alimente la réflexion, au-delà des querelles stériles et des envolées véhémentes. S’il fait réagir, c’est tant mieux, et c’est pourquoi nous nous proposons, dans un troisième temps, de recueillir vos contributions à ce débat *.
* N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse suivante: redaction@comedien.ch

© LDD
Du rire et de ce qu’il en advint
Se sentant attaqué par le réel sur tous les fronts, l’Homme n’a pas trouvé de meilleure riposte à sa condition que le rire. Il a ri du silence infini des abimes, il a ri de ses contemporains et, enfin, il a ri de lui-même. « Le rire est une vertu que Dieu a donné aux hommes pour les consoler d’être intelligents », affirmait Marcel Pagnol dans un bel élan philanthropique. Sans vouloir le contredire, Dieu n’a sans doute rien à voir là-dedans. D’ailleurs, l’Église aime à rappeler que Jésus n’a jamais ri, du moins dans les Evangiles. Il y a plus de 2000 ans, les pères de cette même Eglise voyaient dans le rire un phénomène diabolique, une manifestation d’orgueil et pour finir une menace. Pendant ce temps, Démocrite assurait que tout était digne de notre hilarité tandis que Cicéron répertoriait pas moins de mille façons de rire.
Le débat était lancé, il perdure.
Comme pour tout débat, chaque partie fait feu de tout bois. Et du bois, il y en a ! Tant et si bien, d’ailleurs, que quel que soit le point de vue adopté, on trouve les arguments qui le justifient. Aussi, reprenons depuis le début. Au commencement, donc, était l’ordre et le désordre, le respect et l’irrespect, le sérieux et le manque de sérieux, car la société est ainsi faite – et les individus avec elle – qu’elle ne s’épanouit que dans la contradiction : croire et ne pas croire, respecter et se moquer. Difficile, dès lors, de parler du rire sans parler du sacré. Et plus difficile encore de parler du sacré sans parler du théâtre. Dès les premiers festivals du genre, placés sous le haut patronage de Dionysos, le théâtre a partie liée avec le sacré. La plupart du temps, il s’y associe sur le mode tragique. Mais les Grecs, tout fidèles qu’ils soient à leurs dieux, considèrent qu’un peu de moquerie à leur égard ne peut pas faire de mal. Aristophane sera l’un des premiers à (faire) rire des cieux, notamment en décochant quelques flèches vers l’Olympe dans Les oiseaux. Cet « auteur génial » dont le théâtre est « à la fois comique et politique, ancré dans la cité avec ses héros et son petit peuple qui hurle, commente, se moque, plaisante et se fâche », selon Serge Valletti qui l’a adapté, est le père de la comédie. S’il n’invente pas l’humour, Aristophane en est l’un des pionniers. De son bon usage, il tire les rires de ses contemporains. Car humour et rire, s’ils marchent main dans la main, n’en restent pas moins deux éléments bien distincts. Le premier (parfois prémédité) active le second (pur réflexe) – pour le metteur en scène Jean-Claude Cotillard, « le rire est une fonction du corps qui se libère, ça n’a rien à voir avec l’humour qui se joue au niveau de la parole ».
La différence est de taille, on aurait tort de la négliger. Elle permet d’affirmer – et l’on peut clore cet aspect du débat ! – que, oui, on peut rire de tout, mais qu’en revanche il est plus périlleux de faire de l’humour sur tout et de toutes les manières. L’une des raisons en est donnée par Henri Monier dans son Dictionnaire de poétique et de rhétorique : l’auteur y présente l’humour comme une « ironie de conciliation » et affirme que « contrairement à l’ironie d’opposition ou ironie tout court, l’humour est en général charitable ». Du coup, celui qui adopte une posture énonciative humoristique doit s’abstenir de toute attaque frontale blessante mais doit s’employer à allier mansuétude pour ses semblables et dénonciation des maux qui touchent le genre humain.
Une approche que partage Milan Kundera qui, dans Les testaments trahis, relève que ce qui caractérise l’humour, c’est d’être « bienveillant ». Et il ajoute : « L’humour, ce n’est pas le rire, la moquerie, la satire, mais une sorte particulière de comique, dont Octavio Paz dit (et c’est la clé pour comprendre l’essence de l’humour) qu’il « rend tout ce qu’il touche ambigu ».
Quoi qu’il en soit, la bienveillance humoristique ne signifie nullement l’absence de regard critique. C’est celui que pose Molière sur ses semblables quand il propose de « corriger les mœurs par le rire ». Pour l’auteur des Précieuses ridicules, la comédie doit viser à la correction des errements de l’homme, considérés comme des accidents, tels que l’hypocrisie, l’avarice ou le snobisme. Des errements, donc, pas des différences…
Points de vue
« Sur le plan de la liberté de penser et d’expression, un droit constitutionnel, c’est le droit des humoristes de prendre ce qu’ils veulent pour sujet. Mais si l’on se place sur le plan de la prudence politique, la réponse est plus nuancée : est-il judicieux d’offenser inutilement ? De heurter des groupes non en caricaturant leurs comportement mais ce qui les constitue : la couleur de leur peau, leur sexualité, leur genre…» Simone Manon, professeure de philosophie
« Le problème de l’humour, aujourd’hui, c’est qu’il n’est pas drôle. Il n’est pas drôle parce qu’il ne nous délivre de rien. Il ajoute une tristesse à une tristesse, une impuissance à une impuissance /…/ Il faut renoncer à l’humour quand le rire ne provoque plus que le petit rire de l’acceptation des choses ». Pacôme Thiellement, essayiste
« Si le rire permet de cicatriser, de survivre ? Pour les victimes peut-être. Pour ceux qui voient les choses de loin, confortablement installés, c’est plus douteux. Entendons-nous, je ne fais pas la guerre aux humoristes. On peut être extrêmement insolent, méchant, iconoclaste, mais il faut savoir pourquoi ». François Morel, comédien
« Dans notre civilisation, il y a toujours eu une sorte de prévention contre le rire. Le Nom de la rose d’Umberto Eco, par exemple, décrit très bien cette méfiance sociale. Certes, il y a eu des époques où le rire gras, le rire plein, étaient autorisés, comme avec Rabelais. Mais il y a toujours eu une tendance rigoriste contraire, qui venait sans doute de l’Église. C’est une espèce de lutte constante. Dans l’Antiquité, déjà, Aristophane provoquait un rire immense, extraordinaire. Mais pour Platon, les Dieux ne doivent pas rire. Ces deux tendances ont toujours existé ». Judith Stora-Sandor, professeure de littérature générale
“Les nouveaux humoristes sont exemplaires d’une culture dans laquelle le débat est complètement anéanti. On parle à des convaincus – on recense les convaincus – et ceux qui ne le sont pas sont des peine-à-jouir, des rabat-joie et des bonnets de nuit /…/ Il est vrai qu’il y a un rire subversif qu’on trouve chez Rabelais, burlesque, carnavalesque, farcesque. Mais, aujourd’hui, le rire est d’acquiescement, le rire nourrit et se nourrit de ce qu’il critique, il est totalement intégré dans le système ». François L’Yonnet, professeur de philosophie
« Le rire fonctionne comme une pulsion, il vient du corps et il puise dans nos mécanismes de plaisir les plus rudimentaires de quoi alimenter le moment de récréation auquel il invite. /…/ Dans le mécanisme du rire, il y a la transformation d’autrui en objet /…/Une fois le bouc émissaire choisi, on rira de son nom, de sa situation conjugale, de son métier, de sa couleur, de son âge, bref, de chacune des caractéristiques auxquelles il sera réduit ». Jean-Christophe Blondel, professeur de philosophie
“Et pour ceux qui citent inlassablement Coluche et Desproges en référence, rappelez-vous que leurs positions étaient très claires : ils se moquaient des dominants et quand Coluche faisait une blague sexiste, il était clair qu’il se moquait du gros beauf sexiste et pas des femmes. Quand Desproges riait du cancer ou de la Shoah, il ne se foutait pas de la gueule des cancéreux ou des juifs mais nous offrait une salvatrice catharsis”. Océan, auteur et comédien
“Quel que soit le rire, il renvoie à une image du corps et de la communauté à laquelle nous appartenons. Comique, satire et humour se caractérisent par un certain traitement du corps individuel mais aussi social, comme en témoignent tant les personnages rassemblant les laideurs et/ou excentricités d’une époque – de Diogène le Cynique à Falstaff ou au « chevalier à la triste figure » –, que les communautés qui cultivent le « rire ethnique » – humour « belge » des Français, « irlandais » des Anglais ou « turc » des Allemands”. Jean-Marc Moura, Le sens littéraire de l’humour
“ Seuls le manque de respect, l’ironie, la moquerie, la provocation même, peuvent mettre les valeurs à l’épreuve, les décrasser et dégager celles qui méritent d’être respectées /…/ La vraie valeur n’a jamais rien à craindre de ces mises à l’épreuve par le sarcasme et la parodie, par le défi et par l’acide” Romain Gary
Au delà de cette limite…
Quid, alors, de l’humour vache ? Celui qui asticote, pique, cherche à faire mouche au risque de blesser ? Une fois encore, c’est Aristophane qui nous en fournit un échantillon quand il déclare à propos des femmes : « Il n’est pas possible de vivre avec ces pestes, il n’est pas possible de vivre sans ». L’intérêt, ici, c’est que la pique se pare de velours. On rappelle que le dramaturge grec est considéré comme l’un des premiers auteurs féministes. Ce n’est pas le cas de Paul Claudel, lequel, entre autres révélations, eut celle-ci : « Quand on a vu beaucoup d’Allemandes, qu’une vraie vache fait plaisir ! ». Ce qui, pour le coup, est de l’humour vraiment vache, dont l’ironie passerait mal aujourd’hui puisqu’elle associe misogynie et xénophobie.
Certains poussent le bouchon encore plus loin, sans toutefois jamais basculer. Un exercice d’équilibre auquel se livre Romain Gary dans cet extrait de La Danse de Gengis Cohn où le narrateur raconte cette anecdote:
« Du savon ? Pourquoi du savon ? Non ! Il y a 22 ans que je ne touche plus au savon, on ne sait jamais qui est dedans !
– (…) Qui c’est, hein ? hurle-t-il. Qui c’est, ce savon ?
(…)
– Je refuse ! hurle le Commissaire. Il m’a une très sale gueule ce savon ! Il n’a pas du tout l’air catholique ! (…)
Mais il a tort. C’est du savon de luxe. J’ai entendu un SS à Auschwitz le reconnaître lui-même, avec un bon gros rire : « C’est du savon de luxe, il est fait avec le peuple élu ».
Choquant ? Voilà comment ce passage – dont le ton rappelle celui de la pièce de George Tabori, Mein Kampf (farce) – est analysé par Judith Kauffmann dans “Les Cahiers de L’Herne” consacrés à l’écrivain : « La plaisanterie sur la fabrication industrielle ressortit à l’histoire juive, version noire hyperbolique. Celle que raconte le SS à Auschwitz appartient au registre de la plaisanterie atroce. La juxtaposition des deux anecdotes dans la bouche du pitre juif soulève le problème des limites entre le mot spirituel, provocateur et libérateur, et la blague raciste odieuse ». Et Judith Kauffmann de noter que ce n’est pas le sujet qui importe, mais la situation d’énonciation « qui est cruciale ». Qui parle (imaginez le passage cité dans la bouche d’un Dieudonné) ? D’où ? Pourquoi ? S’il existe des limites, elles sont là. Quant à l’ironie, selon Romain Gary lui-même, elle peut parfois s’avérer bénéfique : « Seuls le manque de respect, l’ironie, la moquerie, la provocation même, peuvent mettre les valeurs à l’épreuve, les décrasser et dégager celles qui méritent d’être respectées /…/ La vraie valeur n’a jamais rien à craindre de ces mises à l’épreuve par le sarcasme et la parodie, par le défi et par l’acide /…/ La dignité n’est pas quelque chose qui interdit l’irrespect : elle a au contraire besoin de cet acide pour révéler son authenticité » écrit-il dans La nuit sera calme.
A ce stade, rien n’est donc résolu. On comprend que, outre le contexte, tout est question de dosage. De perception aussi. Comme le remarque la philosophe Simone Manon, « ce qui est humour, pour l’esprit qui en a, est invariablement reçu comme moquerie, pour celui qui en manque, surtout s’il fait partie de ce qui est visé par le trait d’esprit. Il faut bien voir la dimension spirituelle de l’humour. Il implique une distance critique par rapport à la réalité, une liberté d’esprit qui font défaut à beaucoup, en particulier à tous ceux dont le sérieux, l’inaptitude à la distanciation, les adhésions massives à des croyances sont un objet de prédilection pour l’humour et l’ironie ». Mais elle ajoute aussitôt : « Ce qui ôte toute forme de méchanceté est la manière pour l’esprit qui excelle (en humour) de se sentir partie prenante des ridicules qu’il exhibe et dont il fait rire ». Selon la philosophe, ceux qui sont dénués de cette empathie « ne font rire que ceux qui leur ressemblent alors que le vrai humour fait rire de manière plus générale. Son efficacité transcende les positions partisanes et parfois les particularités culturelles ».
L’humour se ferait donc « avec », jamais « contre ». Un nouvel indice qui, toutefois, n’indique pas où placer le curseur de ce qui relève du « sérieux » et de ce qui peut « prêter à rire ». On n’en sort pas. D’autant plus que l’on peut très bien être raciste et rire d’un sketch qui brocarde le racisme – par bêtise, admettons, mais aussi par manque de culture, de sens du second degré ou d’attention. Comme le constatait Guy Bedos : « Il y a ceux qui applaudissent à tout rompre certains propos ou sketches antiracistes, drôles ou pas drôles – je me situe toujours à la lisière de la farce et du pamphlet – et puis, si ça se trouve, les mêmes, trois heures après, dans un bistrot, ils iront casser du Maghrébin ». Enfin, comme l’a montré une expérience du psychologue américain Thomas Ford, « l’humour sexiste peut affecter la perception qu’ont les hommes de leur environnement social et leur permet de se sentir à l’aise avec des comportements sexistes, sans avoir peur de la désapprobation de leurs pairs ». En clair, l’humour de dénigrement, même si l’intention n’y est pas, joue un rôle non négligeable dans la promotion des préjugés. Ce que Ford commente de la manière suivante : « On voit naître çà et là des injonctions à rire de ce qui nous chagrine pour prouver notre attachement à la liberté d’expression et attester que nous ne sommes pas des êtres psychorigides, mais les auteurs de ces mises en demeure semblent ignorer qu’on peut puiser notre rire ailleurs que dans le rabaissement de celles et ceux qui sont déjà en souffrance ».
Bref, mais qui en doutait, l’humour n’est jamais inoffensif. C’est ce qui fait sa force et le rend indispensable, notamment contre toute forme de pouvoir. « Le rire, du moins dans sa forme ironique et polémique, est-il une continuation de la guerre par d’autre moyen ? », s’interrogeait Philosophie Magazine en 2013. Manière de dire que, oui, l’humour est une arme. D’où l’importance de savoir très précisément qui vise et qui est visé.
L.C.
“Il faut tirer ses flêches contre les puissants”
Suite à sa prestation remarquée dans l’émission Infrarouge, nous avons désiré revenir sur les propos de Dominique Ziegler de manière plus approfondie. Non pour les juger mais pour préciser un mode de pensée qui, de plus en plus, semble gagner du terrain dans le domaine de la culture.
L’engagement artistique consiste-t-il à se moquer des puissants ?
– Le théâtre est l’art du démasquage ; en jouant des personnages fictifs, en mettant un masque réel ou figuré, les comédien(ne)s renvoient au public le mensonge de la société. Le théâtre passe un pacte avec le public : « Nous allons vous mentir avec votre accord », soit l’inverse du pouvoir qui avance masqué en prétendant agir vrai. Le mensonge avoué sur scène renvoie au public le reflet inversé de la réalité mensongère. Intrinsèquement le théâtre pose la question du mensonge structurel par sa propre praxis. Le théâtre évolue dans un monde politique. Dylan chante : « We live in a political world/ Where love don’t have any place/ We are living in times when men commit crimes /and crimes don’t have a face ». J’adore ces strophes ! Notre boulot est justement d’apporter de l’amour et de la vérité. Mettre des noms sur les crimes. Démonter les mécanismes de pouvoir. Comme Molière en son temps.
Dans l’expression artistique les conditions du rire imposent-elle que ce dernier ne puisse s’exercer qu’aux dépends de ces mêmes puissants ?
– Il ne faut pas figer une définition des conditions du rire. Il y a tant de manières de faire rire, le comique de situations, le comique absurde, la farce, le travail de clown, la satire politique. Mais oui, je pense que la finalité du message doit être de tirer ses flèches contre les puissants. Ce qui n’empêche pas de rire de plein de sujets. Beaucoup de bonnes manifestations du rire, renvoient de près ou de loin à une démolition des clichés dominants. Ce n’est pas forcément une règle absolue, mais, en tout cas, quand j’analyse ce qui me fait rire, je m’aperçois qu’il y a toujours une sous-couche politique, même lointaine. Louis de Funès n’est pas vraiment politique, pourtant ses personnages de petits patrons excités ou de policier maladroit portent en eux la critique (aussi gentille soit-elle) des castes qu’il incarne.
On vous a accusé de vouloir établir une liste de ce dont on peut rire, ce dont vous vous défendez. Considérez-vous que certains sujets, notamment ceux portant sur les « minorités », réclament aujourd’hui de la part des artistes une approche plus précautionneuse?
– Cette histoire de liste est un malentendu ; lors d’une émission de télévision, j’ai répondu rapidement au journaliste, dans le feu de l’action, qui demandait quels étaient les thèmes à ne pas aborder pour ne pas heurter certains groupes de personnes minorisées ; il a utilisé les mots de « liste » et « thèmes interdits » que j’ai repris dans la foulée, de façon malheureuse. Ce que je voulais condamner c’étaient les messages transphobes, homophobes, sexistes ou racistes. Qui n’ont rien à faire dans l’humour ou ailleurs. C’est très simple et ça s’arrête là. Plus tard dans l’émission j’ai dit qu’il ne fallait pas faire de liste ou de charte (le dessinateur de presse Chappatte revendiquait sa charte personnelle), mais qu’il fallait juste avoir du bon sens. Malheureusement plus personne n’entendait. Peu importe ; il faut rire de tout et s’exprimer sur tout, c’est évident. C’est tellement évident que je n’avais pas envie d’enfoncer des portes ouvertes, et que je voulais amener le débat ailleurs, justement sur le contexte politique dans lequel ce type de polémiques se déploie. Il est établi, depuis Dieudonné, que l’attaque contre des personnes discriminées sort du champ de l’humour. Quand des personnes déjà stigmatisées par la société, sont moquées de manière agressive et humiliante, il est légitime de s’interroger sur le contexte dans lequel cette moquerie s’opère. Et les artistes, qu’ils le veulent ou non, sont partie prenante de ce contexte. L’expression artistique n’est pas un phénomène hors-sol qui bénéficierait d’un blanc seing total, par décret magique. Il y a des personnes ou des groupes de personnes qui subissent depuis des siècles la violence du pouvoir, au quotidien. (Le terme générique pour les désigner est « minorités », mais il conviendrait plutôt d’utiliser le terme « groupes minorisés », puisqu’il s’agit de personnes ou de groupe de personnes qui subissent une oppression active de la part de personnes plus élevées qu’elles dans l’ordre hiérarchique de nos sociétés inégalitaires. Les femmes représentent par exemple une majorité numérique, mais sont mises en état de minorité politique par le pouvoir patriarcal). Beaucoup de ces groupes minorisés, au terme de décennies ou de siècles de luttes, font aujourd’hui davantage entendre leur voix. Le pouvoir politico-économique – qu’on peut aussi définir comme le pouvoir hétéro-patriarcal blanc (même s’il a des relais et ersatz chez les élites d’autres peuples, voire dans d’autres genres) – tient toutefois fermement la barre. #MeToo n’a pas mis fin au patriarcat, Black Lives Matter n’a pas mis fin au racisme systémique, les combats des différents mouvements LGBTQI+ n’ont pas mis fin à l’homophobie, la lesbianophobie, la transphobie, etc. Le pouvoir effectue au quotidien une contre-offensive pour marginaliser ces luttes car il en a peur. Et cette contre-offensive imprègne toutes les couches de la société, y compris les sphères artistiques. Certains artistes pensent faire preuve de rébellion ou d’esprit transgressif en répercutant des clichés stigmatisants, alors qu’ils ne font que reproduire les diktats de la classe dominante. L’artiste doit réfléchir d’où il parle, de quoi il parle et comment. Tous les sujets sont bien sûr libres d’être abordés. Ce sont les messages qui doivent être réfléchis. Si un message reproduit des clichés discriminants, on a le droit de dire « attention, on n’est plus dans le champ de l’humour ou du théâtre, mais dans autre chose. » Je pense que n’importe quel humoriste peut aborder n’importe quel sujet et n’importe quel personnage. Quand j’ai dit lors de l’émission « il faut réfléchir d’où on vient suivant le type de message qu’on délivre », je voulais bien sûr parler de la place politique. Si on fait partie d’une majorité hétéro-normée blanche et qu’on envoie (qui plus est depuis un organe de pouvoir) des messages jugés discriminants par des personnes exclues de cette majorité, on parle depuis un espace politique hiérarchiquement déterminé. A ce moment là, plus que jamais, la pertinence du message est essentielle. L’humoriste Océan résume ça très bien quand il dit: “Il faut rire avec les personnes minorisées et pas contre” /…/ Il faut ajouter, au risque de donner le fouet avec lequel me faire battre, que notre société, suite aux progrès des luttes et de l’évolution (relative) de la conscience collective, a aussi intégré des normes pénales contre le racisme, l’antisémitisme, et les discriminations de genre (art. 261 bis droit pénal suisse). Ce que j’ai avancé, de manière peut-être maladroite, à l’émission, repose quand même sur un socle concret. Il ne s’agit pas, encore une fois, d’interdire de rire de ceci ou de cela. Il s’agit de connaître notre objectif de vie collective, d’établir quels sont les dénominateurs communs qui nous permettent de cohabiter le mieux en société dans le respect de toute.x.s.
Dans le domaine de la culture, on est très sensible aux « minorités », dont on porte régulièrement les revendications sur scène ou dont on évoque les conditions de vie. Pourtant, lors de la polémique évoquée plus haut, certain.e.s représentants de ce milieu culturel se sont détournés de vous au nom du refus de la « censure ». Comment expliquez-vous cette contradiction ? Qu’est-ce que la censure selon vous ?
– Cette question est en lien avec la précédente. La récente polémique que vous évoquez a démontré qu’il y a des groupes minorisés qu’on peut davantage brocarder que d’autres. La sensibilité du monde culturel est donc à géométrie variable, en fonction, malheureusement, du poids politique des groupes minorisés et de l’ignorance de leur vécu par une grande part de l’opinion publique. Je suis complétement étranger à toute forme de censure. J’ai d’ailleurs passé trois ans de ma vie à écrire une pièce en alexandrins sur le sujet, ce n’est pas pour me retrouver censeur à l’âge de 50 ans (pour paraphraser le Général De Gaulle) ! Nous vivons dans le monde inversé cher à Debord dans lequel « le faux est un moment du vrai ». Il faut donc complétement inverser la problématique. Quand une caste détient tous les leviers du pouvoir (économique, politique, médiatique) n’a-t-on pas affaire à une censure de fait ? Quand on veut s’opposer à cette censure structurelle au nom de la dignité humaine ne fait-on pas, au contraire, preuve de combativité anti-censure ? La censure et la liberté ne sont pas toujours là où on les définit. Je ne doute pas de la sincérité de nombre de personnes qui brandissent l’étendard de la liberté d’expression. Mais il faut leur rappeler que nous vivons dans un monde dans lequel les méthodes d’aliénation et de manipulation des classes dominantes se sont raffinées au fil du temps (au même titre que les luttes se sont accrues). Rousseau dit : « Le faux a une infinité de visages, mais il n’y a qu’une seule vérité. » Pour trouver cette vérité, il convient de se poser les questions suivantes : Où est le pouvoir ? Qui a le pouvoir ? Qui ne l’a pas ? Il y a aussi des réalités contemporaines et historiques à prendre en compte. Faire un sketch déconnant sur les Suisses-allemands ou les Marseillais, ce n’est pas la même chose que faire des sketchs insultants pour les personnes LGBTQI+, noires, musulmanes ou juives. Il y a des groupes de personnes qui ont subi ou subissent toujours la violence de la part du monde hétéro-normé occidental. C’est facile quand on appartient à cette majorité de s’offusquer de la soi-disant censure des groupes minorisés. Le même camp qui manie le stigmate est aussi celui qui s’octroie l’absolution et définit les règles. Voilà un sujet éminemment théâtral d’ailleurs ! Les masques, encore et toujours…
Croyez-vous qu’une pièce a pour vocation de délivrer un message ? Le poétique et le politique sont-ils indissociables ? N’y a-t-il pas un risque de verser dans un théâtre qui ne serait que pédagogique ?
– On peut être militant sans être chiant, comme l’a démontré Brecht. On vit dans un monde où 1% de la population détient la moitié des richesses mondiales, où existent le racisme, le sexisme et toutes sortes d’autres discriminations. Faire abstraction de ce monde me paraît difficile quand on fait du théâtre (ou d’autres formes d’art). Il y a mille manières de se positionner, mille formes et contenus à défendre. Si on revient à la définition stricto sensu de l’objectif d’une pièce, cette citation de Molière, à mon sens, prime sur toute autre : « Je me demande si la grande affaire n’est pas de plaire. » Cela ne signifie pas ratisser large dans une optique consensuelle, mais bien toucher les spectatrices et spectateurs, les captiver, les émouvoir, les secouer, bref faire montre de savoir-faire, utiliser les métiers du théâtre à bon escient et assurer du spectacle tout en faisant passer un message. La notion de divertissement est primordiale, de mon point de vue ; ce n’est pas un vilain mot. Tout n’est pas frontalement politique, sinon on est dans l’agit-prop qui est effectivement une forme qui a ses limites. Personnellement j’ai alterné des thrillers, des comédies, des monologues, des farces ou des fresques historiques. Comme le disait Gérard Gelas, fondateur du Théâtre du Chêne Noir d’Avignon, et également auteur et metteur en scène : « Si on arrive à influencer ne serait-ce qu’une conscience, notre travail n’aura pas servi à rien. » Si on peut le faire en donnant du plaisir, c’est encore mieux ! Une de mes pièces La route du Levant se voulait provocatrice, en créant, par le biais d’une fiction policière, les conditions du débat inexistant dans la vie réelle entre un jeune jihadiste et un représentant de l’ordre républicain, et en renvoyant dos à dos leur violence. A ma grande surprise, c’est celle qui a le plus fait l’unanimité, bénéficiant de quatre mises en scène différentes. Au Théâtre National de Bruxelles, il y avait des débats après chaque représentation ; dans la salle se trouvaient des victimes de jihadistes, des policiers, et des mères de jihadistes. Le théâtre politique tel que je le conçois, n’a pas pour but de simplement dénoncer ou d’exprimer son indignation, mais bien de servir à la réunification cathartique chère à Aristote. Le théâtre politique ne se suffit pas en temps que tel ; son impact doit se prolonger et se vérifier après la représentation. Encore une fois, on ne fait pas du théâtre hors-sol.
On peut dire que les règles de la comédie ont été fixées par Aristophane et que ce registre s’exerçait, dès ses origines, aux dépends du pouvoir. Toutefois, les travers du peuple ont également été moqués tout au long de l’histoire du théâtre. Ce que l’on moque, et souvent sous forme de satire, ce sont les « excès ». N’est-ce pas notamment le rôle des humoristes que de pointer les excès, d’un groupe, d’une attitude et même, pourquoi pas, de revendications ?
– Aristophane défie la notion de temps. La modernité de son travail est ahurissante. Il s’attaque au patriarcat, à l’ordre économique, au militarisme, avec un sens de la dérision totalement décomplexé. On parle d’un auteur qui a vécu cinq siècles avant Jésus-Christ ! Il incarne la satire à l’état pur. Dans ses pièces on trouve des analyses sociales, des piques politiques, des quiproquos ou des gags grivois. Il est la preuve qu’on peut être trash, provocateur, progressiste sans piétiner ou stigmatiser des personnes minorisées. C’est l’état de conscience politique de l’auteur qui détermine de la pertinence ou non de la satire. Bien sûr, il ne faut pas être manichéen, et les travers du peuple peuvent aussi être brocardés ; il y a tant de figures comiques, de professions, de variations de caractères au sein de l’humanité… Par exemple, Molière se moque parfois des paysans ou des valets. Mais à l’exception de George Dandin (qui est davantage une pièce sur les parvenus que sur les paysans d’ailleurs), son message politique n’est pas destiné à brocarder les paysans ; il s’en sert comme figures comiques au sein d’une oeuvre qui tire ses flèches en direction de groupes constitués qui incarnent le pouvoir. Si on revient à la question des valets, Molière leur octroie des rôles différents au fil des pièces (voire au sein de mêmes pièces). Dans Le Misanthrope, le personnage de Basque est un valet maladroit dont les gaffes déclenchent la colère d’Alceste, ce qui engendre des situations comiques. Dans Tartuffe ou dans Le Malade imaginaire, les servantes Dorine ou Toinette incarnent l’insolence et l’intelligence de femmes du peuple en opposition avec la bêtise crasse des bourgeois Orgon ou Argan. Molière suscite un respect absolu car il a mis à profit sa place de dramaturge du Roi Louis Quatorze pour s’attaquer aux incarnations les plus marquantes du pouvoir de son époque : les nobles, les tenants de l’ordre patriarcal, les caciques de l’ordre médical, les bourgeois, l’ordre économique, et surtout l’ordre religieux qui gravitait autour de la Reine-mère et qui comptait des ramifications dans les plus hautes sphères politiques. Ainsi, traiter par le biais de l’humour, au sein d’une œuvre intelligente et aiguisée analytiquement, des différentes catégories de personnes est parfaitement possible. Quand par contre une proposition théâtrale avec une thématique unique brocarde un groupe de personnes dominées, depuis une place de pouvoir, on se trouve face à la situation inverse.
Des personnes minorisées peuvent bien sûr faire l’objet de satire si cette dernière est faite avec intelligence au sein d’une proposition bienveillante et subtile qui élargit le champ d’investigation et d’analyse. Mais si le message final ne fait qu’appuyer les stigmates existants dans la société, on est en droit de s’y opposer. Et là le combat devient politique. Au sujet des « excès » que vous mentionnez, je renvoie à un extrait du dernier livre d’Edouard Louis, écrivain français, victime d’homophobie dès son enfance : « Le monde social vous impose une identité, sale pédé, sale arabe, tu es une femme reste à ta place, et quand vous vous revendiquez de ces identités, ce même monde social vous dit : quelle dérive identitaire ! quel enfermement ! On voit bien que la lutte n’est pas celle de l’identité, mais celle du pouvoir. Celle de savoir qui a le droit de parler, et qui n’a pas le droit. »